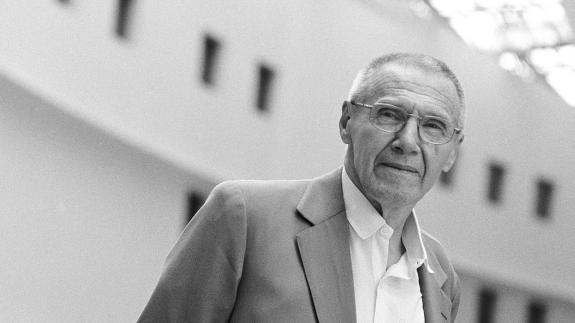Vous souvenez-vous de votre première « rencontre » avec la musique de Philip Glass ?
Vanessa Wagner : C’était en écoutant Einstein on the Beach. Je devais avoir 22 ou 23 ans. Après ça, j’ai découvert les catalogues des labels Nonesuch et ECM, et les musiques de Steve Reich, John Adams, Arvo Pärt, Morton Feldman… Ce fut un grand choc pour moi. Je mettais tout cela en relation avec les musiques électronique et ambient dont j’étais passionnée. À l’époque, cependant, il était pratiquement impossible pour une pianiste « classique » d’aborder ces répertoires en concert. La frontière était tenace et je me souviens avoir été plusieurs fois dévisagée avec un certain « étonnement » lorsque j’évoquais ces noms-là.
Dans ces circonstances, comment la bascule s'est-elle faite ?
De façon presque existentielle. Pendant des années, j’ai joué et enregistré le « grand » répertoire, et je continue bien entendu à le jouer aujourd’hui. Cependant, dès le début de ma carrière, j’ai été attirée par d’autres répertoires, moins empruntés : le dernier Scriabine, Janáček, Schönberg, Dusapin, la création contemporaine… Dans le même temps, j’écoutais toujours beaucoup d’électro ou d’ambient, sans toutefois parvenir à faire le lien avec ma vie de pianiste. En suivant le chemin « traditionnel », j’avais le sentiment de ne pas être complètement moi-même et, pour tout dire, pas complètement épanouie non plus.
En 2016, ma rencontre avec le producteur Murcof a donné vie à l’album Statea, qui mêle le son acoustique du piano et les traitements électronique. Je lui ai ensuite proposé de travailler autour de la musique minimaliste. C’est ainsi que, pour la première fois, j’ai abordé ce répertoire au disque et en concert, dans le monde entier. Ce fut une révélation.
Mon coming out était fait. J’ai voulu poursuivre en solo. J’ai enregistré trois albums autour de pièces quasi jamais jouées en Europe. C’était important pour moi en tant qu’artiste mais aussi pour montrer que ma démarche n’était pas opportuniste, suivant un effet de mode. Tout au contraire : faire un pas de côté, prendre un chemin de traverse, était pour moi une question de « survie » artistique. C’était une façon d’être là où je voulais être en tant qu’artiste, sans même l’avoir réellement formulé ou conceptualisé. Loin de moi l’idée de dire que tout se vaut ou se ressemble, mais je vois la musique comme un terrain d’expression immense, indivisible, du moment qu’elle m’émeut ou me questionne. Aujourd’hui, j’ai la carrière qui me ressemble. Comme dirait Deleuze, je suis enfin devenue qui je suis.
Quels sont les enjeux propres à l’interprétation du piano de Glass ?
Un ami pianiste qui l’a rencontré m’a confié que Glass lui avait dit : « Il faut jouer ma musique comme du Schubert. » Et en effet, comme chez Schubert, on trouve chez lui une apparente simplicité, une élongation du temps, des reprises (beaucoup !), un sentiment de mélancolie, de l’humour, de la nostalgie, de la tendresse. Sa musique exige une vision de la forme dans le temps, un contrôle de l’abandon émotionnel, un toucher coloré, ainsi qu’une certaine réserve qui ne doit pas verser dans la froideur. C’est une musique de l’équilibre qui laisse à l’interprète une grande liberté. Glass aime aussi que sa musique soit visitée par différents types de musiciens – classiques, jazz, pop, néo-classiques – et d’autres compositeurs… Cela en dit beaucoup sur lui et sur sa personnalité de compositeur.
Comment s’inscrivent ces Études de Glass, à la fois dans son œuvre et dans l’histoire plus large du piano du XXe siècle ?
Ces deux livres sont un élément fondamental de son œuvre. On peut les rapprocher des grands cycles d’études qui les ont précédés, même si l'on n’y retrouve ni la virtuosité exigée par celles de Chopin et Liszt, ni la diversité de celles de Ligeti, ni les spécificités de celles de Debussy. Mais le langage qu’on appelle minimaliste, en totale rupture avec ce qui s’écrivait alors en Europe, et tout ce qui avait été fait auparavant, est un maillon essentiel dans l’histoire de la musique.
Je pense que ce qu’on reproche inconsciemment à Philip Glass, c’est d’avoir contribué à rendre plus floues les frontières entre musique dite « savante » et musique populaire, en côtoyant la pop ou la musique indienne, ou en écrivant pour le cinéma, à une époque où la musique « sérieuse », académique, devait répondre à une certaine radicalité. On lui reproche aussi d’écrire une musique « contemporaine » relativement facile à écouter. Personnellement, je pense que, dans son genre, la musique de Glass est très radicale. Obsessionnelle aussi.
Glass raconte dans son autobiographie avoir composé le Premier Livre pour lui-même, afin de palier à ses lacunes techniques. Pour gagner un peu d’argent, il avait besoin de jouer en concert des pièces pour piano et il s’est mis à composer pour lui. Dans ses enregistrements, on entend qu’il n’a pas énormément de moyens pianistiques et certaines de ses Études sont à la portée de pianistes amateurs. Ce double niveau d’écoute et d’interprétation fait toute l’ambivalence de l’œuvre de Glass, et c’est aussi pour cela qu’elle est parfois méprisée. Mais la musique doit-elle être compliquée pour être de qualité ?
Le Second Livre a été écrit pour un pianiste imaginaire, il ne l’a lui-même pas interprété ou presque. Il y va à mon sens encore plus loin que dans le premier.
Comment allez-vous jouer ces vingt Études ?
Dans l’ordre, et sans trop de coupures. Si cela ne tenait qu’à moi, je ne ferais même pas de pause entre les deux Livres ! Ce cycle prend un sens différent quand il est joué dans son intégralité, formant un immense arc tendu entre la Première et la Vingtième Étude – qui, immensément belle, vient à la fois clore le cycle et ouvrir, par son langage, sur un autre monde. Jouer et écouter cette intégrale, c’est y trouver des échos, des résonances, y entendre des creux et des vagues entre les Études, comme des souvenirs qui s’imprègnent. C’est une expérience, un voyage, méditatif et émotionnel, qui prend son sens dans le temps long.
Propos recueillis par Jérémie Szpirglas