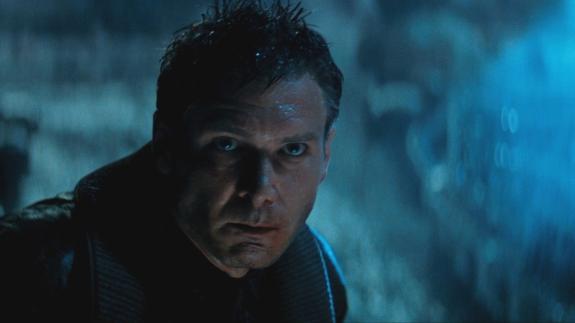Mark J. Butler est professeur de théorie, d’analyse et de cognition musicales à la Bienen School of Music de la Northwestern University (Chicago). Ses travaux sur l’Electronic Dance Music depuis le début des années 2000 se sont distingués par leur approche formaliste, tout en ayant pleinement intégré la dimension interdisciplinaire des popular music studies.
À l’automne 2017, il était invité à prononcer une série de conférences à Rennes et à Paris. Ce passage en France fut l’occasion de le rencontrer et de parler de la genèse de son travail, de ses méthodes et de ses positions. La publication de cet entretien intervient au moment où s’ouvre l’exposition « Electro. De Kraftwerk à Daft Punk » — là même où s’était tenu cet entretien deux ans plus tôt.
 © S. Boyer/Université Rennes 2
© S. Boyer/Université Rennes 2
La musique électronique de danse (Electronic Dance Music ou EDM), en tant que phénomène social, est apparue dans les années 1980. Elle est devenue un objet d’étude académique à partir des années 1990, d’abord pour les sociologues ou les chercheurs travaillant dans le domaine des cultural studies. Son émergence comme discipline reflète l’histoire générale de l’étude des musiques populaires dans le champ scientifique : les musicologues s’y sont malheureusement intéressés sur le tard et, à la fin des années 1990, malgré une hausse des travaux en musicologie sur les musiques populaires, ces études se cantonnaient à des groupes canoniques comme les Beatles, les classiques du rock et ce genre de choses. Quand j’ai commencé à bâtir ma carrière de chercheur en théorie et analyse musicales
J’ai commencé par m’intéresser à la musique, aux morceaux auxquels je prêtais oreille. J’essayais de comprendre leur fonctionnement, et l’une des premières choses que j’ai remarquée, c’est que la musique est faite de nombreuses couches ou textures distinctes : la grosse caisse, la caisse claire, les différentes strates de percussions, la ligne de basse, la variété des voix mélodiques, etc. Toutes sont présentées très nettement, avec des couleurs sonores différentes, et un rythme bien particulier associé à chaque piste individuelle. Selon moi, il y avait forcément quelque chose de plus qu’un « boum boum boum boum » ou une structure en 4/4, ainsi que certains — fans ou musicologues — pouvaient le penser ; si cette musique fascine autant les gens et qu’elle est faite pour danser, il doit y avoir quelque chose de captivant sur le plan rythmique. Dans Unlocking the Groove
La musicologie se passionne pour un certain type de complexité musicale : des rythmes insensés, des éléments dissimulés dans une partition, par exemple, que seul l’universitaire peut mettre au jour. Or cette musique n’a pas cette même complexité structurelle, mais elle permet de faire une experience riche et variée du temps, d’emprunter différentes voies rythmiques et de jouer avec elles à différents niveaux. C’est la thèse que je défends dans Unlocking the Groove.
La musicologie, et en particulier la théorie et l’analyse musicales, s’intéressent depuis très longtemps au canon de l’art occidental et à sa grandeur, et y sont en quelque sorte prises au piège. Si vous allez dans une salle de concert symphonique traditionnelle — non pas comme la Philharmonie de Paris où nous nous trouvons actuellement —, vous remarquerez souvent des portraits d’hommes blancs du xixe siècle accrochés aux murs, qui sont censés représenter les « grands musiciens », et dont la musicologie s’est toujours employée à prouver le génie. Je ne dis pas que la musique électronique n’est pas géniale — je suis intimement persuadé qu’elle l’est —, mais mon travail de recherche ne consiste pas à le prouver. Je pense d’ailleurs que les musicologues qui étudient la musique classique occidentale devraient remettre en cause cette démarche. Notre approche consiste à parler des modes de fonctionnement de la musique et de son rôle dans la société à travers une variété de styles, sans avoir besoin d’essayer de justifier la valeur de ce qu’on écoute. Au commencement de ma carrière, de nombreuses personnes, y compris des professeurs d’université, me demandaient : « Comment sais-tu que cette musique vaut la peine d’être étudiée ? » ou « Est-ce que ça existera toujours dans dix ans ? ». J’y suis désormais moins confronté, ce qui est un signe positif.
On peut parler de nombreux morceaux en termes de diversité interprétative. Par exemple « Piku », le morceau des Chemical Brothers, que j’analyse dans Unlocking the Groove. Je l’ai choisi parce que c’est un exemple très simple de cette approche par strates, dans le sens où coexistent deux couches qui ne sont pas exactement synchronisées. Cela permet à l’auditeur de se concentrer sur une couche rythmique ou sur l’autre, ou encore de faire une expérience intéressante de la désynchronisation de ces deux couches. J’étudie aussi un morceau rythmiquement plus élaboré, « Televised Green Smoke » de Carl Craig. Tellement de choses s’y passent ! Ça commence avec un motif très simple, qui fait « pom pom… pom pom… pom pom… », presque comme un rythme ternaire, mais un autre son arrive et ça devient « pom… pom pom… pom… pom pom… », et finalement la grosse caisse fait son entrée, mais à un endroit où on ne l’attend pas du tout. Cela crée ce que j’appelle un « renversement du beat », et quand il se produit, on se sent momentanément désorienté. Quand la grosse caisse s’ajoute au motif précédent, ça donne « po-dom… pom pom… po-dom… pom pom… », on ne sait plus très bien alors quel motif l’on est censé suivre. Les couches rythmiques continuent de s’empiler et elles finissent par confirmer une interprétation, bien que notre impression précédente des temporalités autonomes persiste.
À l’époque où j’écrivais Unlocking the Groove, il n’y avait pas de recherche en musicologie sur la musique électronique de danse. Il existait un livre d’ethnomusicologie
Dans Playing with Something that Runs, comme son nom l’indique, j’étudie ces morceaux dans le cadre plus complexe de la performance, qu’il s’agisse d’une performance de DJ ou avec ordinateur portable (laptop). J’analyse la manière dont ils sont combinés les uns aux autres, superposés ou altérés par divers moyens. Il est important de souligner que peu d’analyses musicales prennent pour objet les performances, indépendamment de celles de la musique classique, que l’on peut se procurer sur disque, par exemple. Non seulement l’étude de terrain de la performance musicale — en l’occurrence, dans le club — est peu courante, mais elle est difficile à réaliser. Dire que telle chose s’est produite tel jour lors de telle performance est très rare, et cela implique pour moi de filmer les musiciens pendant qu’ils jouent. Or si les enregistrements sont habituellement perçus comme une façon de préserver la performance — il y a un concert, on l’enregistre et on peut écouter l’enregistrement de ce concert —, dans la musique électronique de danse et dans le hip-hop, les enregistrements sont les objets avec lesquels les musiciens jouent, et comme les performances sont improvisées, chacune d’entre elles est fondamentalement différente. Comment comprendre alors cette tension entre ce qui est fixé (les propriétés élémentaires) et ce qui évolue au cours de la performance ?
Les deux ouvrages sont interdisciplinaires, dans le sens où ils s’attachent à la fois aux sons musicaux et à la recherche de terrain. Cet intérêt est apparu pendant ma thèse, durant laquelle j’ai étudié l’ethnomusicologie en plus de la théorie et de l’analyse musicales. Si ces deux champs sont souvent opposés et hermétiques l’un à l’autre, tenter de les mettre en relation a été extrêmement productif pour moi. Il y a deux aspects concomittants dans cette approche : d’une part, l’analyse minutieuse des enregistrements, alimentée par des idées issues de la théorie et de l’analyse musicales qui permettent de mieux les comprendre ; d’autre part, le fait d’étudier comment cette musique peut étendre, mettre à l’épreuve ou élargir les idées des théoriciens de la musique. En effet, de nombreuses propositions théoriques ne s’appliquent qu’à la musique savante de l’Europe de l’Ouest entre 1750 et 1900. Considérer différents répertoires permet de révéler certaines lacunes quant aux outils utilisés, qu’il s’agisse des manières de parler de la musique ou de l’étudier. Dans Unlocking the Groove, le travail de terrain a consisté à réaliser des entretiens avec des DJs et des producteurs (les personnes qui créent et jouent la musique), ainsi que quelques fans de musique électronique. J’ai conservé cette méthode pour Playing with Something that Runs en filmant des performances et en les analysant, ce que je n’avais alors jamais fait. J’emprunte aussi des idées à la philosophie (notamment en matière d’ontologie de la musique) et aux sound studies. J’ai commencé à travailler sur Playing with Something that Runs en 2005 et l’ouvrage a été publié en 2014 ; durant son élaboration, les sound studies étaient en train de se constituer comme discipline — le livre pionnier de Jonathan Sterne, The Audible Past
Je m’intéresse depuis longtemps à ces questions et j’ai commencé par étudier des choses très simples, comme le remix. Dans la musique électronique de danse, et même dans la musique plus pop, on peut trouver plusieurs versions d’un même morceau, sans pour autant savoir laquelle est définitive, si tant est qu’il en existe une. Cela pose d’emblée une question ontologique. Si les musicologues ont toujours été obsédés par l’idée de déterminer la version definitive des choses, ce n’est pas ce que je tente de faire ici. Les producteurs eux-mêmes utilisent de manière très précise des termes ontologiques : il leur importe que leur morceau soit reconnaissable comme tel, ce qui signifie qu’il doit avoir une identité musicale, et c’est une question ontologique. Quel est ce morceau et quelle caractéristique nous dit qu’il s’agit bien de ce morceau ? Bien sûr, j’essaie plus généralement de développer une méthodologie de l’ontologie qui permette de couvrir à la fois la multiplicité et le changement, la nature fluide de ce genre de musique. « Multiplicité » signifie dans ce cas qu’il existe différentes versions d’un même morceau et que ce dernier est composé de divers éléments, en particulier les boucles et les échantillons. Si on prélève un échantillon dans un morceau préexistant pour l’intégrer à un autre morceau et qu’il reste reconnaissable, il transporte des composantes de son identité dans le nouveau morceau, comme une sorte de marqueur ontologique atténué du morceau précédent. On peut alors se demander quel est le statut de ce nouvel objet hybride. Je m’intéresse par consequent à ces structures multiples que l’on trouve dans la musique électronique de danse, ainsi qu’à leur évolution au cours du temps. L’exemple le plus parlant, et sans doute aussi le plus significatif pour illustrer ces questions, est le suivant : un enregistrement issu d’un studio est mixé avec d’autres enregistrements issus d’autres studios pour donner cet objet d’ordre supérieur qu’est le set du DJ.
Pour parler de l’ontologie des performances en matière de musique électronique de danse, j’ai eu recours à trois categories liées entre elles : l’œuvre, le texte et la performance. « Œuvre » fait référence à tout type de structure dotée d’une identité musicale que nous pouvons reconnaître comme telle. Lorsque j’emploie le mot « œuvre », j’essaie précisément de déconstruire l’idée conventionnelle que l’on en a, pour lui préférer un sens ontologique. J’emploie le mot « texte » pour parler d’une chose inscrite sous forme matérielle. L’exemple le plus évident est celui des sillons d’un disque vinyle, mais bien sûr, tout enregistrement est un texte, une partition est un texte — même si ça n’a pas d’importance pour ce qui nous concerne —, un fichier numérique est un texte (inscrit dans la mémoire numérique). Enfin, la « performance » est l’événement réel dans sa temporalité intersubjective. J’utilise les termes « œuvre » et « texte » de manière distincte, parce que je crois important de faire droit à la matérialité, mais aussi de prendre en compte le fait que les gens font référence à l’identité musicale dans ce genre.
Dans le troisième chapitre de Playing with Something that Runs, qui porte sur l’improvisation, je propose deux analyses, l’une portant sur une performance d’un DJ, et l’autre sur une performance réalisée avec laptop. L’approche fondamentale consiste à s’emparer d’un enregistrement ou d’un ensemble d’enregistrements, de les analyser individuellement pour en révéler les propriétés élémentaires, puis d’analyser la façon dont ils sont mobilisés dans la performance, de comparer ces usages et dans certains cas, de comparer différentes performances. J’ai étudié l’un des morceaux les plus connus de Jeff Mills qui s’intitule « The Bells », puis la façon dont il est mobilisé dans un mix réalisé en studio, « Purpose Maker Mix », qui a été publié sur le DVD Exhibitionist
Quand je me suis penché sur la question, j’ai analysé un segment du mix d’une longueur de dix minutes ; les propos les plus précis portaient sur la partie comprenant « The Bells ». Un autre morceau est en train d’être diffusé et Mills y intègre progressivement « The Bells ». Je me suis demandé à quelle partie du morceau correspondait la performance, et j’ai donc essayé de faire un schéma élémentaire de sa structure. À mon grand étonnement, je me suis rendu compte qu’à un moment, on passait du milieu du morceau à son début presque instantanément ! En examinant attentivement l’enregistrement vidéo et avec mes connaissances en matière de DJing, je me suis rendu compte qu’il utilisait en réalité deux disques de « The Bells ». C’est une technique répandue parmi les DJ, mais il le fait de manière virtuose, ça va très vite. Cela signifie — en particulier du point de vue ontologique — qu’on entend la partie du morceau dans laquelle se trouve le motif des cloches qui se développe et finit par disparaître, et c’est à ce moment qu’il rejoue le morceau depuis le début, pour que l’on entende de nouveau le motif des cloches. Il ne joue pas tellement la seconde moitié du morceau, celle qui est comme dissociée de la première moitié. Mills consolide l’identité du morceau par le biais de sa technique de DJ. Il en met en valeur son motif typique, il le rend bien plus présent et le fait durer beaucoup plus longtemps tout en réduisant très nettement la partie moins reconnaissable, mais la chose intéressante à ce propos, c’est qu’il renforce l’identité du morceau par la rupture même. C’est en fragmentant la surface ou la structure de l’enregistrement original et en passant abruptement d’une partie à l’autre qu’il crée davantage d’unité.
Dans le canon et les conventions de la musicologie, l’ontologie est comprise comme étant reliée au concept d’œuvre, en particulier depuis la construction d’un canon au XIXe siècle, dans lequel on suppose que chaque composition est une « œuvre » unique et définitive. Lydia Goehr parle de la manière que nous avons de conceptualiser les œuvres musicales presque comme si elles étaient des sculptures, comme si elles avaient la même permanence
Gibson a proposé une psychologie écologique, au sein de laquelle il s’est intéressé à la perception visuelle
Dans la musique électronique de danse, ce terme d’affordance gibsonienne souligne la manière qu’ont les gens — en l’occurrence, des musiciens — d’interagir avec les appareils. Nombreux sont les travaux sur la musique électronique, menés aussi bien par des journalistes que des universitaires, orientés par l’histoire des techniques, dans laquelle l’accent est mis sur des personnes — typiquement des hommes — qui inventent une technologie particulière qui aurait en quelque sorte révolutionné la musique. J’essaie de me tenir éloigné de ce genre d’approches, souvent reliées à une forme de « déterminisme technologique », qui consiste à dire qu’une chose est créée en vue d’un certain but et que ses propriétés déterminent ses usages. Au lieu de parler de cette technologie, de cet échantillonneur, de ce séquenceur, de ce logiciel, de ce contrôleur, pour donner quelques exemples, je me concentre plutôt sur l’idée de la surface. L’interface est la surface, c’est le côté interactif. Quelles sont les affordances des interfaces ? L’approche psychologique de Gibson étant écologique, on trouve aussi cette composante si l’on considère que l’interface est en fait la somme de tous les appareils rassemblés par le musicien : c’est un écosystème qu’il peut parcourir de différentes manières, en empruntant des chemins variés qui correspondent à autant de façons de naviguer sur cette surface.
J’imagine qu’il est important que les musiciens aient des signaux visuels, particulièrement dans l’environnement du club, parce qu’ils cherchent à atteindre une fluidité dans le jeu, une capacité à utiliser ces contrôleurs et interfaces avec la même fluidité que les musiciens jouant un instrument acoustique. Cela est souvent lié à la correspondance entre geste et son : on fait quelque chose avec la main et le résultat est directement perceptible. Les signaux visuels sont-ils un substitut aux retours haptiques