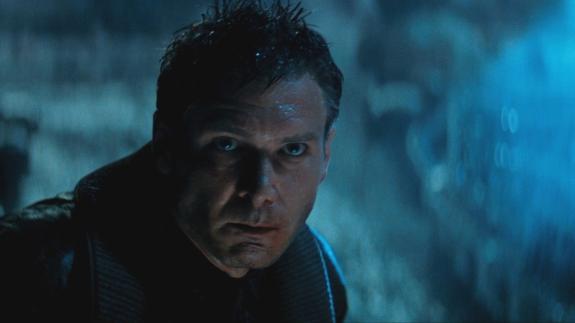Dans l’un de ses derniers romans, La Pluie d’été (1990), elle glisse, subrepticement et malicieusement, une allusion à la musique qui paraît révélatrice de la place accordée à cet art. Ernesto, enfant prodige, qui sans être allé à l’école, est venu à bout de la connaissance humaine en quelques mois (et surtout de la philosophie allemande), se tient devant un instituteur désemparé :
L’instituteur : Non, je ne sais pas, je ne sais rien. Qu’est-ce qu’il reste à votre avis Monsieur Ernesto ?
Ernesto : Tout à coup, l’inexplicable… la musique… par exemple.
Déjà en 1969, dans un entretien radiophonique à propos de son film Détruire dit-elle (1969), Duras parle de la musique comme de l’insaisissable : « Je pense que la musique on ne la détruira jamais parce qu’on ne la connaît pas. On n’en a pas fait le tour. Je crois que personne n’a entendu Bach encore. Personne n’a assez de disponibilité en soi pour l’écouter. »
Les goûts musicaux de Marguerite Duras sont pourtant plus éclectiques que ne le laisserait supposer une affirmation aussi grandiloquente. Elle aimait par-dessus tout partager la musique avec ses amis. Elle écoutait aussi bien Bach que Bob Dylan, Léo Ferré, Charles Trenet, Édith Piaf, Catherine Sauvage, Jeanne Moreau ou encore Harry Belafonte. Elle adorait écouter en boucle « Capri c’est fini » avec Yann Andréa. Le piano a joué un rôle crucial toute sa vie. Dans ses entretiens filmés avec Michelle Porte, Duras évoque son amour de cet instrument, son plaisir à en jouer et son regret de ne pas être une meilleure pianiste. Le personnage de la mère pianiste, accompagnatrice de films muets pour arrondir les fins de mois, dans L’Éden Cinéma (1977) fait partie de la mythologie durassienne. À l’instar de la Maurice Léon Bollée ou de la Lancia de Calcutta, le grand piano noir et le phonographe sont des personnages à part entière de son univers. Les allusions aux instruments sont constantes (le piano, mais aussi le violon), les scènes de bal et de concerts privés multiples, les ritournelles incessantes et les musiques insérées dans les récits et les films foisonnantes. Cette omniprésence de la musique est loin d’être ornementale, elle rejoint la logique interne de l’œuvre et implique un processus complexe de déplacement et de métamorphose des références musicales.
Certaines musiques sont répétées de livres en livres, de films en films. On peut entendre la quatorzième variation de Beethoven sur un thème de valse de Diabelli dans Des journées entières dans les arbres (1977), ainsi que dans Le camion (1977) et India Song (sans oublier bien sûr que l’enfant de Moderato Cantabile apprend une sonatine de Diabelli qui structure le roman et se reflète dans le titre). De même, Duras évoque de manière répétitive L’Art de la fugue qui apparaît à l’écran dans Nathalie Granger (1972) et dans la section finale du film Détruire dit-elle. Cette intertextualité musicale exacerbée s’inscrit dans une parfaite subversion des différences génériques. Le cinéma, « ce truc pourri » ne devient joie que lorsqu’il se rapproche de la musique : « Une joie : cinéma comme on dit : musique. » Duras déclarera d’ailleurs que :
« De tout ce que j’ai fait, de tous les films que j’ai faits, le plan qui me bouleverse le plus, c’est le plan sur la musique, sur l’écriture musicale, sur les partitions, dans Nathalie Granger. On a mis une masse de partitions par terre, et la caméra se balade sur les partitions, elle finit, je crois, sur L’Art de la fugue, sur la couverture de la partition ; elle doit passer très près de la Chaconne, elle finit sur la plus dure, c’est-à-dire sur L’Art de la fugue, ou peut-être sur les Variations Goldberg, je ne sais plus, tandis que l’enfant fait des gammes. »
Les souvenirs et sensations liés à une musique ne sont donc jamais contenus dans une œuvre, mais débordent en séries et en cycles, impliquant ainsi le lecteur et le spectateur dans un processus de signification en devenir permanent.
Lieux musicaux
Les « lieux de Duras » sont traversés de musique. Ces espaces abstraits ont l’insolite d’une musique suspendue. Les bungalows de l’Indochine coloniale où l’on joue les airs surannés de Paris, les salons de réception des ambassades, où, au rythme d’un blues, l’être se dilue dans un ennui morne, les salles de casino où la passion devient sublime au son des violons, les quais d’un port industriel où se jouent des drames passionnels sur fond de sonatine malhabile, tous ces lieux sont des paysages mentaux et sonores, de véritables chambres d’écho. Dans sa postface à La Pluie d’été, Duras précise que l’espace choisi pour le roman, Vitry, est « le lieu le moins littéraire que l’on puisse imaginer, le moins défini ». Puis elle ajoute : « Je l’ai inventé. Mais j’ai gardé les noms des musiciens, celui des rues. » À travers les allusions à des morceaux de musiques réelles (de Bach, Beethoven, Chopin, Schubert), à des chants fictifs (de Savannakhet, la Neva), à la chanson populaire (de Souchon, Saint-Granier), à des genres musicaux (fox-trot, blues, jazz) et à des airs enfantins, s’élabore une géographie imaginaire épurée qui déjoue les codes réalistes, mais s’organise selon un « sens musical ». « L’Inde chacun la reconstruit. J’ai pris des mots, Chandernagor, Mandalay, pour leur musique », précise Duras à propos du Vice-Consul (1965).
L’espace, ainsi marqué par la métaphore musicale et l’insertion de musiques, est aussi lié à une vision du temps. Temps suspendu des scènes qui s’inscrivent dans la syncope musicale et graphique, dans ces fameux blancs, plages d’anesthésie, temps nié par la répétition incomplète et insatiable des chocs initiaux, tout cela tient de la mesure qui fixe une étendue et une durée.
Ritournelles et opéra de voix
Les ritournelles, les airs populaires et enfantins sont aussi signes du temps qui s’écoule, à jamais perdu, comme dans L’Après-midi de Monsieur Andesmas (1962) où un refrain chantonné est à la fois signe de ravissement et de mort prochaine. L’air de « Ramona », tube des années trente, hante Un barrage contre le Pacifique (1950), il s’apparente à une féérie pour enfants élevés dans la sauvagerie coloniale et familiale : « C’était l’hymne de l’avenir, des départs, du terme de l’impatience. » Les textes du cycle d’India Song sont parcourus par une figure de mendiante dont le chant médiatise une expérience de la souffrance. Impénétrable, la chanteuse délirante qui a marché du Laos jusqu’à Calcutta, exilée, chassée, est un personnage magnifié, une figure symbolique de la perte d’individualité et de l’oppression coloniale.
La douleur parvenue à l’insoutenable tient souvent de l’« opératique » pour reprendre le néologisme de Rimbaud. Duras parle de ses livres comme « des voix publiques, des voix qui ne s’adressent pas ». La représentation de la voix est souvent assimilée au chant ou au cri et accompagnée de musique, composant une forme d’opéra déconstruit. Le rapprochement est plus particulièrement pertinent dans le cas d’India Song qui repose sur un système de voix très complexe. La scène de bal du Ravissement de Lol V. Stein (1964) avec sa théâtralité archétypale, rappelle les « opéras de l’être abandonné ». Dans L’Amant (1984), les bagarres entre les frères sont présentées telles des scénographies chantées : « Ma mère, en toute circonstance, accompagne la scène d’un opéra de cris. » Le jeu de l’analogie avec le modèle de l’opéra élabore un lieu commun : il peut nous « faire voir les voix ».
India Song ou la composition musicale
India Song est peut-être l’écrit le plus musical de Duras. « Texte, théâtre, film », comme l’annonce le titre, il se situe dans une oscillation générique. Dionys Mascolo, qui fut le compagnon de Duras, disait ceci de sa transcription cinématographique : « Cette tragédie cinématographique est tout entière construite comme une composition musicale. […] Tout le film images comprises est écrit comme une partition. »
La quatorzième variation de Beethoven vient conclure chacune des quatre parties du texte qui, à la manière d’actes dans une tragédie, circonscrivent des espaces-temps différents. Point nodal de la construction, ce morceau de Beethoven ne peut être, selon Roland Barthes, compris par une simple audition, mais engage une lecture proche du texte littéraire moderne : « De même la lecture du texte moderne (telle qu’on peut la postuler, la demander) ne consiste pas à recevoir, à connaître ou à ressentir ce texte, mais à l’écrire de nouveau, à traverser son écriture d’une nouvelle inscription, de même lire ce Beethoven, c’est opérer sa musique, l’attirer (elle s’y prête) dans une praxis inconnue. » C’est moins le thème de la modernité que celui d’une « praxis inconnue » qui semblerait en effet importer pour Duras.
Musique : écrire dit-elle
La musique est souvent métaphore de l’écriture elle-même. Dans un entretien de 1984, Duras s’exclame : « Il n’y a de composition que musicale dans tous les cas, c’est ce réajustement au livre qui est d’ordre musical. Si on ne fait pas cela, on peut toujours faire les autres livres, ceux dont le sujet n’est pas l’écriture. » La référence à la musique est d’ordre de la « métaphore vive » : elle recouvre une dimension existentielle par rapport à laquelle l’écriture se jauge. À propos de la musique de Duke Ellington, Duras affirme ainsi : « Mais en même temps il y a une éternité dans ces choses-là : Sidney Bechet, Duke Ellington […] On dirait un train qui passe comme ça… »
Inexplicable, éternité, insaisissable tous ces mots que convoque le discours de Duras sur la musique sont éminemment romantiques et peuvent irriter, mais ils reflètent l’inquiétude profonde de l’écriture. Duras disait encore de ses livres qu’ils étaient écrits dans un lieu incertain, entre musique et silence :
« J’aimais la musique avant tout. Plus que tout. C’est pour ça que j’écris des livres. J’écris des livres dans une place difficile, c’est-à-dire entre la musique et le silence. Je crois que c’est quelque chose comme ça. On rate toujours quelque chose, ça c’est forcé, c’est une obligation dans la vie, j’ai raté la musique. »
Duras ne parle pas de transposition mais d’un lieu, celui de l’entre-deux, où l’écriture s’élabore. Il semble s’exprimer une admiration sans bornes et une tendre irrévérence pour la musique que l’on garde par-devers soi.