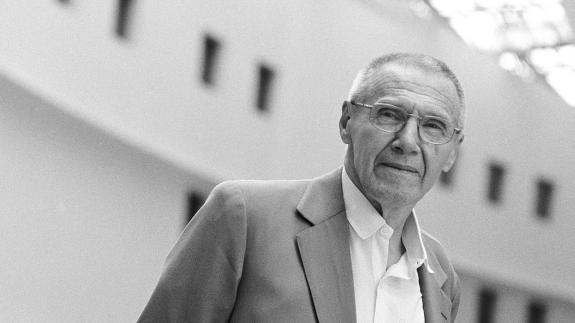Vous avez réalisé une adaptation dans laquelle vous dansez tous les personnages : Carmen est un soldat, mais aussi un gitan qui se transforme en torero. Combien de personnalités avez-vous invitées à vous posséder ?
L’idée était de faire une Carmen très jonda [des tréfonds, d’après l’expression andalouse de cante jondo, pour désigner les chants les plus archaïques et profonds du flamenco – NdT], ma propre Carmen ; en plus de la danse d’une femme libre, il y a la danse du soldat, qui est un homme amoureux, et aussi celle du torero. Il y a beaucoup de choses, la danse flamenco et non flamenco, gitane, non gitane. Nous avons pris ces trois personnages et nous avons tout ramassé pour que ce ne soit pas un grand opéra, mais pour en saisir l’essence.
De quoi parle-t-on quand on parle d’une Carmen jonda ?
Je vois le flamenco comme un art très individualiste. C’est basique : un cantaor qui chante, un autre qui joue de la guitare et un troisième qui danse. Quand on joue Carmen, par contre, il y a un danseur qui fait ceci, un autre qui danse cela, un corps de ballet… Mais dans cette Carmen, il n’y a ni décor ni corps de ballet. Don José chante pour moi et je danse pour lui. D’où le côté jondo.
Lorsqu’est né le flamenco tel qu’on le connaît aujourd’hui, au XIXe siècle, l’opéra était un genre en plein essor, et il me semble que de nombreux artistes de flamenco ont été inspirés par lui, tandis que de nombreux compositeurs étaient inspirés par le flamenco.
Oui, il est vrai que si l’on parle, par exemple, des ballets, les artistes de flamenco se sont approprié le mot. Et dans le cas présent, je trouve que la musique est jonda, et leur façon de chanter me donne un pellizco [pincement, NdT], qui ravive le corps et fait danser de manière très juste. Il ne s’agit pas de bien danser, ni de danser de manière très virtuose. Il s’agit d’écouter la musique et de danser tout en écoutant la voix.
Est-ce que vous passez par les différents styles de flamenco dans les différentes scènes ? Ou est-ce que vous dansez de manière plus libre ?
Je danse la musique de Bizet, et j’y vois toutes sortes de styles, j’y vois des bulerías, des seguiriyas, des tangos. Car bien sûr, c’est une musique qui se fonde sur un imaginaire sévillan, et qui donc le transmet.
Le fait de venir de Séville vous a-t-il influencé ? Car le mythe de Carmen y est enraciné…
Je crois que oui, venir de Séville joue un rôle. Car je me promène dans la ville et je vois Carmen, Don José, Escamillo dans les gens d’aujourd’hui. C’est pourquoi je pense que si un Sévillan le fait, il le fait d’une façon différente.
De plus, vous faites venir un chœur d’Oulu, en Finlande, appelé Mieskuoro Huutajat, le Chœur des hommes qui crient.
En effet, c’est à la fin, Carmen est dans l’arène et je crois que le public est important à cet endroit. Dans le flamenco et l’opéra, la voix est importante – et donc, il m’a semblé qu’à titre de son d’ambiance, des gens qui crient permettraient de clore la fête en beauté.
L’humour est la marque de fabrique de la maison – comment l’avez-vous introduit dans cette tragédie ?
On ne peut pas danser sans avoir le sens de l’humour. Pour la Carmen que nous allons faire, je me suis fié davantage à la musique qu’à la danse. Je vois tout cela comme quelque chose de très joyeux, une expression de l’envie de vivre. Je n’aperçois de tragédie nulle part, car nous n’expliquons pas le livret, nous reflétons une Carmen libre. Tout est enveloppé de l’exagération qu’est la musique, et de fantaisie. C’est de là que provient l’humour. C’est beau. Même s’il y a des hommes qui crient, on termine par l’amour, pas par le couteau. Et c’est très bien comme ça. Je ne veux pas raconter la mort de Carmen : ici, on n’a pas besoin de voir comment ils la tuent.
Que doit avoir un classique pour que vous osiez l’embarquer dans votre univers ?
Cela vient avec le temps, quand on se rend compte que l’on peut faire de nouvelles choses avec les œuvres qui ont toujours été là. Les classiques ne se démodent jamais. Nous avons toujours vécu avec Nijinski et avec L’Amour sorcier, mais quand, par exemple, retentit la première note du Sacre du printemps, le théâtre change. Il y a des jeunes qui sont venus le voir, et ils sont repartis comme s’ils venaient de voir un truc de hip hop. L’Amour sorcier m’a aussi permis de relier les classiques aux jeunes générations. Quand je danse le Sacre, je dialogue avec le musicien, comme je le fais dans L’Amour sorcier, et il en est de même avec Bizet : c’est avoir une conversation avec un artiste d’une autre époque, c’est comme une machine à voyager dans le temps.
Traduction : Caroline Sordia