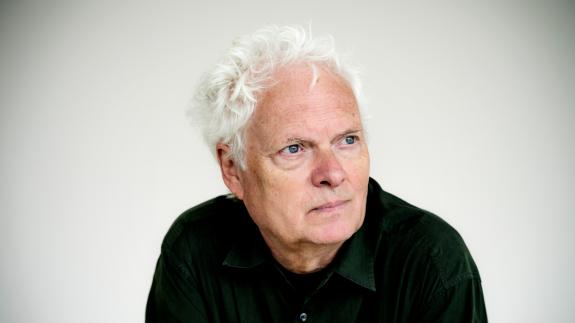Le succès mondial d’un marronage culturel
En 1986, Kassav’ donne quatre concerts au Zénith de Paris puis sept en 1987, neuf en 1988, dix en 1989… Ce sont les années où l’Afrique déploie pour Kassav’ des foules jamais vues pour des artistes non africains ; où Miles Davis parle du zouk comme d’un courant révolutionnaire qu’il faut découvrir ; où Kassav’ est le premier groupe majoritairement composé de Noirs à chanter en URSS. Les ventes se comptent par millions d’exemplaires dans le monde, et par dizaines de millions de cassettes de contrefaçon dans les pays du Sud. Même quand Kassav’ n’est plus la coqueluche des médias occidentaux, c’est encore le premier groupe français à jouer au Stade de France, en 2009. Seuls des artistes de musique électronique ont, parmi les Français, autant arpenté la planète : près de quatre-vingts nations et territoires visités de 1985 jusqu’aux derniers concerts de la tournée d’hommage à Jacob Desvarieux, emporté par le Covid-19 en 2021. Kassav’ a chanté dix-sept fois aux Pays-Bas, a mené treize tournées aux États-Unis et dix au Cap-Vert ou dans les stades d’Angola — où est créé en 2018 un musée consacré au zouk.
En termes d’impact international, le zouk n’atteint certes pas la puissance planétaire du reggae jamaïcain qui, outre sa valeur intrinsèque, a bénéficié de son expression anglophone et du succès mondial fulgurant et bref de Bob Marley — exactement huit ans, de la sortie de l’album Catch a Fire en 1973 à la mort du chanteur en 1981. Le zouk se répand avec les succès de Kassav’ et de suiveurs antillais d’abord, puis avec ceux d’artistes de plusieurs aires culturelles d’Afrique, des Amériques latine et centrale ou de l’océan Indien. Il démontre une fois de plus la plasticité de perception des musiques créoles, immédiatement familières dans toutes les cultures car toujours tangentes de formes « natives » d’ici ou là.
Le zouk s’affirme en tant qu’objet du Tout-Monde prédit par Édouard Glissant, c’est-à-dire un monde dans lequel chaque personne, chaque communauté, chaque culture se relie potentiellement à toutes les autres d’une manière imprédictible, sans terra incognita possible. Autrement dit, cette forme musicale construite par une créolité nourrie d’éléments de tous les continents ou presque, tangente ou cousine avec des musiques de partout et surtout des univers musicaux du plus vaste monde. Le zouk ne se réduit pas à une exoticité lorsqu’il navigue dans le « Sud global » et dans les Occidents non francophones. Il porte au contraire des élans vers des parentés imprévisibles — rythmiquement, harmoniquement, comme dans sa capacité à faire sauter sur place des spectateurs qui jamais n’ont entendu la langue créole francophone de l’Atlantique. Construit à partir de matériaux que l’on peut isoler comme les siens propres en étant natif de plusieurs continents et de dizaines d’espaces humains et historiques, le zouk annonce — comme le reggae peu avant lui — l’entrée possible du monde dans une créolisation générale.
Le zouk au cœur d’une réflexion identitaire
En ce qui concerne les territoires d’origine du groupe et de sa musique, associer la pulsion de percussions traditionnelles appartenant à l’univers quotidien des Antillais à des percussions électroniques et des boucles de boîtes à rythmes a ouvert une importante voie symbolique pour un public perpétuellement écartelé entre la fidélité et le mépris pour son passé, comme il est écartelé entre la modernité qui arrache à l’arriération de l’esclave et les valeurs d’un « progrès » au douloureux coup de rabot assimilationniste. L’ambition originelle de Pierre-Édouard Décimus et Desvarieux vise explicitement un potentiel développement international, au-delà des populations antillaises francophones. Mais rien ne pouvait annoncer l’importance presque existentielle du succès de Kassav’ pour les Antilles françaises. Car l’éclosion et l’explosion du zouk y sont concomitantes d’un certain nombre de réflexions identitaires. Alors que le mythe d’une « métropole » accueillante dépérit tout autant que le sentiment de pérennité associé aux modes de vie traditionnels, alors que les Antillais ressentent de plus en plus l’écart entre leur niveau de vie réel et leur aspiration à une société de consommation à la « française », le zouk montre des Antilles culturellement prospères.
Jusque-là, et à chaque génération sur des modalités nouvelles, les Antillais se sont questionnés sur leur identité. Kassav’ apporte soudain une réponse : ce petit peuple parle au monde entier avec une musique connexe à la plupart des musiques du samedi soir, mais qui porte la marque de la puissance de résistance d’Africains mis en esclavage. Le zouk apporte une incontestable fierté nationale après plusieurs générations de départementalisation et d’espérances déçues quant à la promesse de devenir des Français « comme les autres », après l’échec de la conquête de l’indépendance par l’action armée ou par la mobilisation électorale, après que l’économie de plantation se fut écroulée sans qu’une autre activité économique dominante ne garantisse un niveau d’emploi suffisant. Le rayonnement international de cette musique se double du sentiment aigu de sa modernité alors qu’elle s’assoit sur des rythmes associés à la généalogie afrodescendante de l’écrasante majorité de la population. Et cette fierté est d’autant plus forte que le zouk n’emprunte pas directement aux cultures dominantes française ou états-unienne. L’humiliation ressentie par Pierre-Édouard Décimus devant la déculturation ambiante aboutit à une singulière reculturation, qui poursuit sans l’éclipser le réveil des tambours ou la mutation des carnavals en arène culturelle.
Groupe pop au sens le plus beatlesien du terme, Kassav’ est à la fois un compétiteur sur le marché concurrentiel des produits culturels et une institution structurant l’évolution des représentations que plusieurs peuples se font d’eux-mêmes. De fait, le groupe agit comme un mouvement culturel dont l’influence dépasse le champ de son esthétique et de son milieu professionnel, comme l’ont fait le Théâtre national populaire de Jean Vilar, l’orchestre de Duke Ellington ou les Ballets africains de Fodéba Keïta. Le zouk ne transforme pas seulement la musique des Antilles françaises, il agit sur leurs sociétés.
Si l’emploi du terme n’a pas été revendiqué par Pierre-Édouard Décimus ou par Desvarieux, il n’est pas impropre de parler de marronnage culturel en ce qui concerne Kassav’. Métaphoriquement, le collectif choisit la voie du « petit marronnage » des îles exiguës des Petites Antilles, qui consiste à se perdre dans la foule de Saint-Pierre ou à s’évader quelques heures dans la nuit pour vivre un peu de liberté avant de retourner en apparence à la docilité forcée de la plantation — un marronage n’exigeant pas le courage colossal des évadés risquant leur vie à plus ou moins court terme, et donc accessible à une proportion plus grande des personnes esclavagisées. Il s’agit d’une forme perlée, souterraine, subreptice du marronage quand Kassav’ chante en créole des textes à double sens ou à double fond, seulement intelligibles par les créolophones. On repère alors une continuité avec les groupes folkloriques en madras bien repassé glissant des chansons exprimant la révolte et la résistance devant le préfet et les ministres en visite. Sans le théoriser et sans le revendiquer, Kassav’ se fait cheval de Troie d’une conscience clairement afrodescendante, créole et anti-assimilationniste.
Entre divertissement et engagement politique
Pourtant, le zouk suscite de fortes résistances aux Antilles. D’une part, à rebours des clichés — parfois même véhiculés par des responsables politiques ou des intellectuels antillais —, la danse et la fête ne sont pas une seconde nature des Guadeloupéens et des Martiniquais. Au contraire ! Depuis la naissance de ces sociétés dans l’économie d’habitation du XVIIe siècle, la danse est soumise à la censure de maints pouvoirs : la police, l’administration ou les élus locaux perpétuent parfois l’ancienne voix du maître au nom de l’ordre public, tandis que le clergé catholique, les diverses dénominations évangéliques et un fort courant puritain laïque s’expriment plus bruyamment que dans la société « métropolitaine ». D’autre part, à mesure que la musique de Kassav’ déferle sur les ondes et dans le quotidien de l’espace public, des censeurs de divers bords lui reprochent de détourner la population du combat nationaliste, du développement économique ou des bonnes mœurs. Le zouk serait alors le symbole d’Antilles écervelées s’abandonnant coupablement au plaisir.
Une partie des corps intermédiaires et des leaders d’opinion refusent fermement d’exprimer leur fierté pour l’impact international du zouk. À l’inverse, ils s’inquiètent que cette image puisse paraître descendre de l’esthétique des cartes postales exotiques et, en touchant le grand public populaire de l’industrie du divertissement, représente une variante postmoderne du vieux doudouisme. La question de la langue se débat à front renversé : si le groupe ne s’exprime pas en français, il lui est paradoxalement reproché de ne pas chanter en anglais, langue « universelle », ou de ne pas être plus explicite dans son propos politique toujours véhiculé sans slogans. Alors même que la litote, le sous-entendu ou le double sens irriguent toute la culture créole, des voix antillaises réclament à Kassav’ d’adopter le langage direct et dru de la chanson engagée française ou du reggae jamaïcain.
 — Kassav’ à Bercy en 2024
-
© Guillaume Aricique
— Kassav’ à Bercy en 2024
-
© Guillaume Aricique
Incontestablement, pourtant, le zouk professionnalise le milieu musical antillais comme aucun autre genre ne l’avait fait auparavant. Du milieu des années 1980 au commencement du XXIe siècle, il paraît entre cent-cinquante et deux-cent-cinquante albums de zouk par an : le nombre d’artistes et de groupes actifs explose dans les îles autant qu’en « métropole », avec la montée en compétences techniques de toute la filière musicale — qui s’effondrera avec l’explosion du piratage numérique dès 1999-2000, avant même que la crise du disque ne dévaste l’industrie discographique en Europe.
En outre, le zouk donne une visibilité inédite aux femmes. Jocelyne Béroard de Kassav’ ou les chanteuses de Zouk Machine portent une parole féminine voire féministe dans la musique populaire antillaise qui n’avait jamais fait de place qu’aux clichés sentimentaux et à un dolorisme genré complice du machisme consubstantiel aux structures matrifocales des sociétés créoles. Le rôle de Jocelyne Béroard, notamment, dépasse la seule performance de sa chanson « Kolé séré » au Top 50 avec Philippe Lavil en 19871. Son album Siwo, en 1986, rapproche la culture créolophone de la liberté d’expression féminine européenne ou états-unienne. Dans l’expression du désir comme dans celle d’un égalitarisme romantique, dans des récits de pratiques de couples particulières aux Antilles comme dans son regard souvent acide sur la société de son île, elle se fait porte-parole de femmes massivement invisibilisées et silencées par la culture populaire créole. Comme une Oum Kalthoum pour l’Égypte ou une Amália Rodrigues pour le Portugal, son statut déborde du succès commercial pour s’insinuer dans une forme d’attachement identitaire et « national ».
La déconsidération d’un genre à l’importance internationale
Or, malgré le poids pris par le zouk sur place et dans le monde, la France ferme volontiers ses portes à cette musique, d’une part en raison de son habituelle condescendance pour les populations d’outre-mer, d’autre part par la survalorisation de musiques héritées d’autres esclavages que la traite dans le domaine colonial francophone. Extrêmement peu de plumes de la presse musicale, par exemple, comprendront que Kassav’ n’est pas seulement une « musique du soleil » et aborderont la dimension politique de son parcours. Il est vrai que la langue créole, moins intelligible que l’anglais pour les journalistes français, enveloppe d’un enjouement apparent des textes souvent très graves.
De même, la perception de l’empreinte de Kassav’ sur le paysage des musiques sera sous-évaluée et déformée. L’hostilité de la critique des médias grand public envers le zouk love capitalisera sur l’invention de ce sous-genre par Jean-Philippe Marthély et son incarnation majuscule par Patrick Saint-Éloi, pour stigmatiser une prétendue dérive commerciale de Kassav’. Or si le zouk love est une forme de décadence du zouk, il est aussi sa créolisation au carré, à la fois son échec historique et son rejeton le plus insolent. Cette forme secondaire et industrialisée vaut par sa rusticité, sa candeur revendiquée et son mauvais goût assumé, y compris dans le détournement-appropriation de certaines sonorités de synthétiseurs ou d’arrangements vocaux de chœurs féminins empruntés aux variétés internationales, et jusqu’à l’usage massif de la langue française par une foule d’interprètes à la charnière des XXe et XXIe siècles.
Il restera à Kassav’ et à ses îles le sentiment de beaucoup d’occasions manquées. On peut voir un symbole dans le fait que la diplomatie française soit systématiquement absente lors des tournées du groupe à l’étranger, contrairement à d’autres gloires hexagonales. Certaines ambassades en Afrique finissent par avoir des contacts avec ces citoyens français qu’après de nombreux séjours faisant la « une » des médias locaux et seulement quand une tension avec un producteur ou avec une administration exige l’intervention de leurs services. Et, dans le discours journalistique contemporain, le regard français sur l’énorme puissance commerciale et culturelle du reggaeton ne mentionne jamais l’importance du zouk dans la généalogie du genre et de ses sous-genres — comme le dembow, avatar d’une rythmique jamaïcaine devenue hégémonique en décalquant la pulsion du zouk.
Passé l’émerveillement d’un déferlement ressenti comme un effet de mode — ce qu’il est, au fond, pour les médias français des années 1980 —, il semble que le zouk n’ait pas la possibilité d’accéder à la noblesse des genres reconnus comme rebelles et pleinement non européens. Il faudrait par exemple un relevé systématique des nuances d’appréciation entre le reggae et le zouk, musiques créoles nées dans des îles de la Caraïbe distantes de moins de 1 700 kilomètres, et dont la construction obéit à des mécaniques proches2. Le plus superficiel sondage dans les archives de presse révèle une dissymétrie entre un regard sur une musique de la fierté, de la revendication et du combat noir — ce que n’est pas uniquement le reggae — et une musique récréative voire touristique — ce à quoi ne peut se réduire le zouk.
La familiarité ancienne du public français avec la biguine, l’influence d’une variété « tropicale » (de David Martial à La Compagnie créole), le positionnement résolument non politique des membres de Kassav’ pendant leurs interviews promotionnelles, surtout sur la question de l’indépendance, peuvent expliquer une part de la réputation de tiédeur faite au groupe et à sa musique. Mais il nous semble que la minoration systématique de l’importance planétaire du zouk tient à la dissymétrie dans les consciences françaises entre des musiques qui seraient historiquement liées au crime de l’esclavage (du blues au reggae) et d’autres qui resteraient à jamais piégées dans le regard colonial, y compris chez des leaders d’opinion sommairement anticolonialistes, et seraient condamnées par l’absence de conscience d’un esclavage français.
Extrait de l’ouvrage à paraître : Bertrand Dicale, Musiques nées de l’esclavage (domaine français), Paris, Éditions de la Philharmonie, coll. « La rue musicale », 2025.
- 1
Sur une composition de Jean-Claude Naimro et enregistrée en duo avec lui, la chanson est d’abord parue en créole sur un album de Jocelyne Béroard, son autrice. Puis Philippe Lavil, chanteur martiniquais blanc, l’enregistre avec elle pour le marché « métropolitain », lui chantant en français et elle dans la langue originale.
- 2
Que l’on nous permette de renvoyer au chapitre consacré à « l’effet vélo » dans notre ouvrage Ni noires ni blanches : histoire des musiques créoles, Paris, Éditions de la Philharmonie, 2017, p. 149.