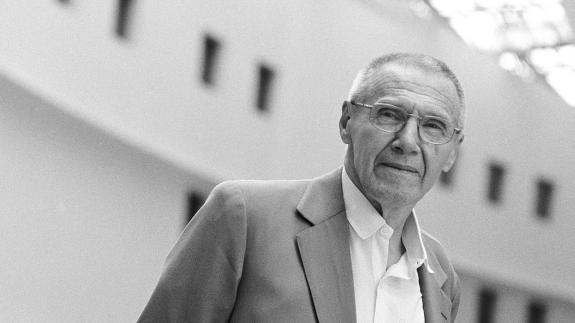Dès l’ouverture d’Akhnaten, cela ne fait aucun doute : c’est du Philip Glass. Dans quelle dimension, dans quel monde musical nous emmène-t-il ?
C’est une musique répétitive : on ressasse un motif. Progressivement, ce motif se transforme de manière imperceptible, par la rythmique, par une modification harmonique très lente, ou par des changements de pulsations et de tempo. Ce qui caractérise Philip Glass, c’est cet effet hypnotique qui se produit immédiatement. Il se situe aussi sur une forme de simplicité harmonique – d’où le nom de minimalisme, d’ailleurs. Ce n’est pas une musique qui fonctionne comme le répertoire romantique, sur des idées de modulations et de chromatisme. Et cette simplicité apparente cache une réelle complexité rythmique.
À quoi correspond, dans les années 1960, ce rejet de l’univers atonal et arythmique ?
Il ne s’agit pas d’un rejet à proprement parler. Les Américains ne rejettent pas, ils cherchent une voie qui leur appartient. Il s’agit essentiellement d’une tentative de démarcation, d’une recherche d’identité musicale propre. Le rejet s’est plutôt manifesté plus tard, en France, chez ceux que l’on appelle actuellement les néotonaux, des compositeurs qui, par réaction, rejettent tout discours basé sur un langage atonal. La France est un pays qui aime la polémique, cette idée que l’histoire de l’art est rythmée par les affrontements entre anciens et modernes. Les querelles ont scandé la musique occidentale et française ! Les Américains sont moins enclins à cet esprit de chapelle, me semble-t-il.
 — "Akhnaten" de Philip Glass par Lucinda Childs. Production : Opéra Nice Côte d'Azur, 2021.
-
© D. Jaussein / Opéra Nice Côte d’Azur
— "Akhnaten" de Philip Glass par Lucinda Childs. Production : Opéra Nice Côte d'Azur, 2021.
-
© D. Jaussein / Opéra Nice Côte d’Azur
Quelle est la signature du compositeur, par sa formation orchestrale ? À quels instruments particuliers la doit-on ?
Philip Glass supprime les violons de son effectif. L’orchestre est donc davantage ancré dans les graves. Cette écriture et cette orchestration, faites de blocs et construites par masses, contiennent beaucoup de doublures, ce qui est très spécifique. Ainsi, il arrive que la formation entière joue le même motif en même temps, ce qui peut créer un sentiment d'épaisseur ou de lourdeur auquel il faut prêter attention. L’ensemble doit absolument rester léger. Philip Glass aime beaucoup les percussions, elles sont très présentes. Une autre particularité est l’ajout d’un orgue. C’est une marque très forte de son orchestration, rattachée à la musique pop des années 1970-1980. L’orgue donne une couleur assez singulière, une teinte entre l’orchestre symphonique et l’orchestre variété ou pop, un peu à la manière des Pink Floyd.
On sent également chez Philip Glass une forme d’autodidactisme. En effet, il n’a pas de formation classique, et pour cette raison-là, sa musique n’est pas forcément facile à jouer. Par exemple, certaines répétitions systématiques de motifs aux clarinettes, flûtes et hautbois peuvent sonner un peu lourd, et il faut savoir en tant que chef aider l’orchestre à trouver l’équilibre. De plus, généralement, les tempos que marque Philip Glass ne doivent pas être pris trop littéralement. Il faut vraiment envisager de jouer cette musique avec beaucoup de souplesse. L’écriture de Philip Glass a un côté mécanique, à l’opposé de la ductilité qui fait la marque de la musique romantique européenne. La répétition a presque quelque chose d’inhumain, qu’il faut dépasser quand on la joue. Il s’agit d’adapter les tempos, de ne pas hésiter à les pousser un peu lorsqu’ils sont rapides, ou à les retenir lorsqu’ils sont lents, pour gagner en contrastes et en flexibilité. Il est également important d’aménager des transitions entre ces tempos, de façon très fluide, jamais abrupte, pour ne pas casser le flux musical. Si on observe Philip Glass interpréter lui-même ses propres compositions, on remarque qu’il amène beaucoup de fluidité et de souplesse. Il ne joue jamais de façon mécanique et raide, et donne toujours un aspect très organique. Et c’est ce que je vais continuer à essayer de faire, avec Akhnaten, pour ne pas rompre le charme de la musique.
On observe également un rejet de la storia. Spectacle non narratif : mais que raconte Akhnaten ?
D’Akhnaten on ne sait finalement pas grand-chose. C’est une figure de pharaon presque mythologique, voire mythique. Les trois actes représentent trois états, trois moments de son règne : la mort de son père et son arrivée sur le trône (acte 1), l’instauration d’une nouvelle religion liée aussi à son histoire d’amour (acte 2) puis sa chute et la trace qui reste de lui dans le monde présent (acte 3). L’opéra balaye donc toutes les années du règne d’Akhnaten, de sa naissance à sa ruine. L’œuvre peut se lire comme une bande dessinée musicale, où chaque scène serait un moment de la vie du monarque. Cet opéra a plus à voir avec l’oratorio dans sa dimension sacrée et mythique qu’avec l’opéra à proprement parler. Il n’y a pas d’action courte ou de coup de théâtre, mais à chaque fois une scène qui installe un climat et une idée musicale, un état d’Akhnaten, une nouvelle facette du personnage.
 — "Akhnaten" de Philip Glass par Lucinda Childs. Production : Opéra Nice Côte d'Azur, 2021.
-
© D. Jaussein / Opéra Nice Côte d’Azur
— "Akhnaten" de Philip Glass par Lucinda Childs. Production : Opéra Nice Côte d'Azur, 2021.
-
© D. Jaussein / Opéra Nice Côte d’Azur
Comment l’œuvre est-elle construite et à quelle dramaturgie correspond cette construction ? Chanter des langues mortes, des textes sacrés, le sanskrit, l’égyptien, l’akkadien, dans un opéra biographique non narratif : quelle est l’intention du compositeur, musicalement et vocalement ? Quel est ce langage ?
Il existe une volonté de Philip Glass d’une sorte de vérité historiographique. Ainsi il faut qu’Akhnaten s’exprime dans la langue qu’il était supposé parler. Dans un second temps, c'est un moyen de mettre l’auditeur à distance du texte, et aussi les interprètes qui le récitent, et finalement de les voir comme les fantômes d’une mythologie, surgis du passé. On fait revivre une figure d’une civilisation éteinte et on met un filtre entre elle et nous, à travers cette langue que personne ne comprend tout à fait. Cette langue disparue qui renaît sur scène, c’est ce qui permet de rêver je pense, de se projeter dans un ailleurs.
C’est toujours une vraie question pour le compositeur de savoir en quelle langue écrire. Un mot, c’est tellement puissant, fort de sens, qu’il peut souvent prendre le pas sur la musique. Faire parler les personnages dans une langue que personne ne comprend, finalement, va pousser l’auditeur à plutôt focaliser son attention sur la musique et moins sur le texte. Je crois qu’une distanciation se crée ainsi. Stravinski, d’ailleurs, ne fait pas autre chose lorsqu’il décide d’écrire Œdipus Rex en latin.
La seule fois où Philip Glass ramène Akhnaten du côté de l’humain, du public et du vivant, c’est le moment où il chante son grand air, un hymne, qui est en anglais. C’est un moment très beau, une sorte de prière d’Akhnaten, où d’ailleurs, il se fait plus humain, alors que dès le départ on le désigne comme un dieu sur terre. À ce moment-là, il se rapproche, dans ce qu’il raconte de son attachement à la nature, à l’amour, de thématiques propres à l’humanité entière. On est dans l’incarnation d’un homme qui nous parle tout à coup dans un langage bien vivant, avec toute l’intensité symbolique qui y est associée.
Ce langage vous parle-t-il ? Qu’entendez-vous ?
J’entends des situations théâtrales sur lesquelles je m’appuie. Quand les prêtres sont en train de prier, j’entends une prière dans une église, une lointaine pyramide égyptienne ancienne, un grand espace. Au moment de la chute, j’entends une armée qui s’approche. Ces situations m’aident à orienter les interprètes vers le son que je souhaite entendre et l’intensité qu’ils doivent mettre dans chaque pièce.
Propos recueillis par Mélanie Aron
Cet entretien a paru dans le programme de salle de la production d'Akhnaten de Philip Glass (novembre 2021) à l'Opéra de Nice -Côte d'Azur.