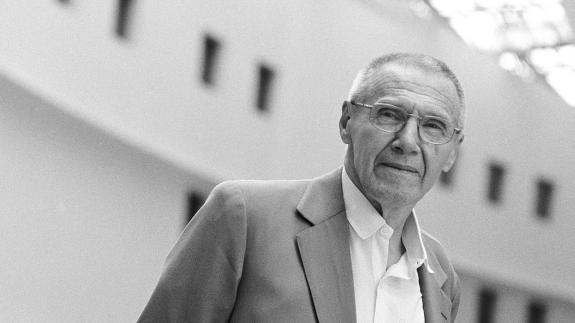La viole de gambe est maintenant un instrument plus si méconnu qu’il l’était il y a quelques années, mais ce qui n’est pas toujours clair pour le grand public c’est qu’on ne parle pas d’un instrument mais de toute une famille d’instruments, la famille des violes de gambe, donc tous les instruments qui vont se jouer sur les jambes, qui sont à cordes frottées et qui ont six ou sept cordes. On a de toutes les tailles, plus c’est petit plus c’est aigu. Ça commence avec le dessus de viole, la viole soprano. Au XVIIIe on aura même encore plus petit : le pardessus de viole qui viendra jouer, même voler le répertoire de violon. Il a vraiment la même tessiture que le violon . Donc après, le dessus de viole, qui est la tessiture d’une femme qui chante. On a des altos différents, en la, en do, on a des ténors, souvent en sol. À chaque fois l’instrument est accordé différemment. Et on a le plus connu parce que c’est là qu’il y a le plus de répertoire soliste, c’est la basse de viole, qui existe pendant longtemps à six cordes mais aussi à partir de fin XVIIe-début XVIIIe en France avec une septième corde qui est une corde de la grave. Après il y a des violes encore plus grosses que la basse : la consort basse, la great basse, les violones, des petites contrebasses mais qui appartiennent encore à la famille des violes. Pour ce programme de disque La Messagère, que je vais donner en concert, c’était ça la question : qu’est-ce qui reste, qui est vraiment de l’ordre de l’identité de la viole française et qui demeure du XVIIe jusqu’à la musique contemporaine. Je dirais que c’est très virtuose mais c’est une virtuosité avec beaucoup de modestie, une virtuosité qui n’est pas démonstrative. Ce n’est pas en force, il y a peu de choses qui sont en force et ça, ça rejoint aussi une caractéristique essentielle de la viole en tant qu’instrument. Il y a l’idée de quelque chose de très noble, qui est aussi l’identité de la viole française. La musique a l’air apparemment très simple surtout quand on ne joue pas tous les ornements. Mais si on devait écrire note à note tout ce qui se passe, aussi techniquement, c’est extrêmement difficile, cela demande beaucoup de précision. Tout est dans les détails, tout est dans la subtilité. C’est le mot qui me revient : la modestie de faire quelque chose de difficile mais que ça n’ait jamais l’air d’être un effort. La viole que je vais jouer pour ce concert, je l’ai déjà jouée il y a deux ans maintenant pour le programme Bach/Abel. Mais c’était de la musique allemande, donc pas encore idéal. Là je suis très contente pour ce programme purement français parce que c’est vraiment l’esthétique de cet instrument-là et c’est la musique qu’elle me demande quelque part de jouer. Pour toute la partie du programme qui est les pièces de Sainte Colombe ou Marin Marais, c’est vraiment l’instrument parfait, on a les sept cordes mais on a encore une esthétique un peu ancienne, on a beaucoup de résonance, ce qui fait partie de cette musique. Ce qui va changer aussi c’est le diapason : j’ai mis cet instrument dans un diapason très bas, comme c’était à l’époque de Sainte Colombe. Cela fait que l’instrument est justement un peu moins tendu, donc il va projeter avec moins de puissance mais il va être beaucoup plus performant pour les petits ornements, beaucoup plus réactif à tous les petits détails, les petits embellissements, enrichissements qui viennent amener du croustillant au discours et qui sont vraiment le propre de cette musique. Ce qui est assez spécifique aux instruments anciens c’est que quand ils ne sont pas joués tous les jours, quand on arrive et qu’on refait connaissance, nous, on a une petite phase d’adaptation et d’écoute mais l’instrument met aussi une vingtaine de minutes à se redévelopper et à ce que le son revienne. On y va petit à petit, c’est vraiment une boucle entre ce qu’on ressent et ce qu’on écoute. Souvent, les compositeurs qui commencent à écrire pour la viole me demandent des partitions anciennes pour voir un peu comment on écrivait, quelles clés, quelles tessitures, quels sont les accords que les compositeurs utilisent. Parfois ce sont des gens qui sont déjà très connaisseurs de la musique baroque et de la viole de gambe et qui ont envie d’écrire pour cet instrument parce qu’ils ont déjà dans l’oreille, qu’ils le veuillent ou non, la musique de Marin Marais par exemple. Je pense à quelqu’un comme Philippe Hersant qui est un grand amoureux de Marin Marais, qui connaît très bien cette musique, qui sait déjà quels sont les accords, les choses qui vont bien faire sonner l’instrument. Il y a des compositeurs qui essaient d’arriver avec des oreilles plus fraîches. Je pense à Claire-Mélanie Sinnhuber par exemple qui m’a écrit un solo, qui connaît aussi très bien cette musique mais qui a d’autres influences, qui est très inspirée par la musique japonaise par exemple. Il y a des compositeurs qui ne sont pas français et qui arrivent aussi avec leur bagage autre sur la viole. Je travaille avec un compositeur italien, Guido Umberto Saco, qui est pianiste, donc lui a les mains dans Brahms, Schumann, Schubert tout le temps donc il s’intéresse au répertoire de viole mais forcément je sens un petit peu de tradition XIXe. Pour l‘instant je n’ai jamais tellement senti cette envie de repousser les limites de l’instrument chez les compositeurs contemporains. Il y a davantage de respect et d’humilité à essayer déjà de comprendre cet instrument, ce qu’on peut faire ou ne pas faire. On n’obtient pas si facilement que ça ce que l’on veut. Le travail avec les compositeurs est extrêmement varié suivant les contextes. Parfois ça va très vite, parfois ça prend des années. Parfois les compositeurs connaissent déjà très bien l’instrument donc ils m’envoient une partition. Je la travaille, je peux faire des petites corrections, souvent il y a des propositions. Et donc on a un peu l’impression, fièrement, en tant que violiste, quand on participe à une création, que c’est aussi notre création. On a un petit doigt qui est venu proposer quelques notes par-ci par-là, donc ça devient des œuvres très personnelles. C’est ce que j’aime dans le travail avec les compositeurs contemporains c’est qu’ils ont tous leur personnalité, leur langage, et ils font tous sonner l’instrument d’une manière différente, et me sollicitent aussi en tant qu’instrumentiste, me demandent des choses différentes, souvent que je ne sais pas encore faire, parfois que je ne sais toujours pas faire, mais c’est extrêmement stimulant, et pour l’instrument et pour l’instrumentiste.
C’est à la Renaissance que la famille des violes de gambe – qui, comme leur nom l’indique, se tiennent sur ou entre les jambes – se répand depuis l’Italie jusque dans toute l’Europe : la viole, devenue l’instrument aristocratique par excellence, est la destinataire d’un très riche répertoire où Anglais et Français s’illustrent tout particulièrement. Parmi les différents instruments de tailles variées qui forment cette famille, la basse de viole est la plus connue. Comme ses sœurs, elle compte six (voire sept) cordes et un manche avec des frettes. Si c’est elle qui résiste le plus longtemps à la concurrence de la famille des violons, elle finit par céder sa place au violoncelle vers 1760. La « redécouverte » de l’instrument durant la seconde moitié du XXe siècle, l’intérêt des musicologues et luthiers ainsi que l’arrivée sur la scène musicale de violistes de premier plan ont permis à la viole de faire résonner de nouveau son timbre particulier, à la fois riche (notamment en raison de son grand nombre d’harmoniques), doux et changeant.
C’est peut-être en partie à cause de son histoire singulière que la viole se prête si bien à jeter des ponts entre les époques et les esthétiques. Cette envie, dont témoigne un temps fort qui en explore différents chemins, semble animer beaucoup de violistes. Salomé Gasselin, Révélation soliste instrumentale des Victoires de la musique 2024 et figure montante d’une nouvelle génération de musiciens, propose ainsi pour ses débuts à la Philharmonie un dialogue entre Purcell et Keith Jarrett avec la complicité de Kevin Seddiki. Le concert sera précédé d’une rencontre avec la violiste.
Autre grande représentante de l’instrument, Lucile Boulanger fera sonner l’une des plus anciennes violes du Musée, un instrument rare, en jouant elle aussi la carte du voyage entre les époques : face aux Français (d’origine ou d’adoption) Nicolas Hotman, Sainte Colombe et Marin Marais, elle interprète des pièces contemporaines de Sinnhuber, Hersant ou Pesson, dont certaines ont été composées spécialement pour elle.
Pour clore ce temps fort placé sous le signe de l’ouverture, Romina Lischka orchestre une soirée faisant converser la musique baroque française avec des musiques extra-occidentales : chant arabe et chant dhrupad d’Inde du Nord. Elle s’entoure de Ghalia Benali et de Vincent Noiret, qui conjugue contrebasse et chitarra battente, une guitare italienne.