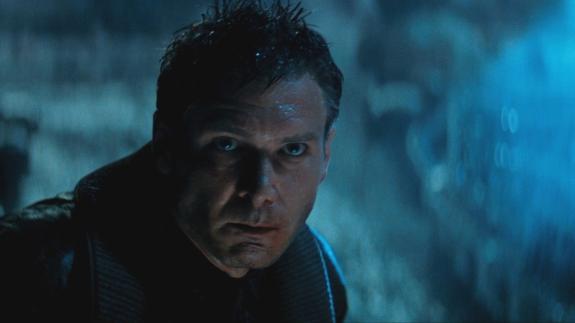Le musicologue Claude Abromont revêt l’habit d’enquêteur dans ce livre dédié à l’œuvre musicale la plus singulière du romantisme français, la Symphonie fantastique d’Hector Berlioz. Extrait.
Aborder la Symphonie fantastique sous l’angle onirique incite à utiliser les outils d’interprétation psychanalytique et notamment le déplacement et la condensation, mécanismes fondamentaux du rêve que Freud a brillamment dégagés. Une première étrangeté nécessite une grande attention : l’empoisonnement à l’opium que peint la Symphonie est le récit d’un fait réel, à ceci près que ce n’est pas Berlioz qui en est le « héros », mais son propre père. Souffrant d’un mal incurable de l’estomac, il a tenté par ce moyen de mettre fin à ses jours. Au lieu de le tuer, l’opium l’a guéri. Berlioz rapporte le fait dans ses Mémoires. Que signifie un tel déplacement du suicide paternel vers celui du héros de la Fantastique, double déclaré de Berlioz lui-même ? Ce suicide, miroir de celui de son père, poursuivrait alors un but thérapeutique ? De quoi souffre-t-il donc ? Le vocabulaire utilisé dans le programme est sans ambiguïté : « obsession », « cerveau malade », « idée fixe », il s’agit du vocabulaire de l’addiction, qu’il ne faut évidemment pas prendre ici au premier degré ; Berlioz est prisonnier d’une drogue symbolique. Harriet Smithson ? Probablement, mais plutôt comme une sublimation shakespearienne d’une obsession encore plus violente, caractéristique de la génération romantique qui ouvre le XIXe siècle : l’art et la musique. Ses écrits et sa correspondance le crient à chaque ligne, il y pense nuit et jour, il est hanté, obsédé, le sommeil le fuit, il renonce à la vie réelle pour s’enfermer fiévreusement dans la bibliothèque du Conservatoire de Paris.
Pour découvrir le sens du déplacement, il suffit de substituer à la drogue symbolique son objet : contrairement à son père, ce n’est pas à une maladie qu’il doit survivre, mais au choc du monde artistique qui s’est entrouvert pour lui à la suite de sa découverte du théâtre de William Shakespeare, des opéras de Gluck et des symphonies de Beethoven. Le projet fantastique berliozien possède d’évidence un sens thérapeutique, cathartique. À l’image de la miraculeuse résurrection paternelle, survivre à la dépendance à l’art qui lui a fait abandonner médecine, famille et amis, ne peut être que le fait d’une « overdose », d’une folie de création, un passage de l’autre côté, en devenant lui-même un génie, un dieu, quitte à créer la légende d’un mouvement écrit en une nuit.
Le programme le dit de façon encore plus explicite : « Il rêve […] qu’il assiste à sa propre exécution. » Oublions momentanément le prosaïque cadre narratif pour interroger le sens profond d’une telle phrase. Attribuée à un jeune musicien dont aucune oeuvre importante n’a encore été jouée (on dit couramment « exécutée »), elle devient limpide. La guérison ne peut être que « l’exécution » de la symphonie elle-même, symbolisée par l’exécution capitale qui clôt le quatrième mouvement. Cette exécution doit être fulgurante, tomber sur le public comme un couperet, le tétaniser ; la chose est pour lui capitale ! Et la réussite fut absolue. Son originalité, sa puissance terrassèrent l’auditoire : la mémorable création propulsa Berlioz au rang d’artiste reconnu. Le rite de passage eut lieu et il en sortit compositeur. Du stade de fantasme, l’exécution de sa musique était passée à celui de réalité et il y avait assisté. Son premier geste fut de détruire quasiment toutes les oeuvres précédant la Fantastique.