Du sens musical1
Je remercie la Philharmonie de Paris, non seulement comme on remercie de toute invitation, mais je la remercie de me donner l’occasion de cette rencontre que j’ai acceptée, car elle est pour moi l’occasion d’avancer dans une terre inconnue. Je n’ai jamais vraiment parlé de la musique, même si j’ai écrit quelques textes qui en approchaient, et surtout pas dans une enceinte ni devant un public qui suppose autorité en la matière. Je n’ai aucune autorité, aucune expertise en matière musicale, je ne suis qu’un auditeur, et si je suis un témoin selon l’appellation des soirées, je le suis en tant qu’auditeur et même auditeur moyen, attentif, mais dépourvu de tout moyen musicologique. Et c’est peut-être pour cette raison que je suis depuis longtemps — très longtemps — intrigué par la question du sens de la musique. En tant que philosophe, je sais à quel point la musique a pu être chargée de significations, depuis l’éveil ou le contrôle de tels ou tels affects, jusqu’à l’expression de l’âme du monde, depuis la mobilisation de passions jusqu’à l’invocation de mythes. Je sais aussi combien de cultures racontent l’origine du monde dans la musique, dans la vibration par exemple d’un arc divin. Et je sais surtout combien la musique a toujours défié, voire tout simplement désarmé le désir philosophique de donner ou de produire du sens. Je sais aussi, mais très peu en fait, quelle énorme quantité de débats, d’interprétations et de propositions théoriques existe et depuis très longtemps sur le sens musical.
(Avant d’aller plus loin, je vais mettre ici une première ponctuation musicale. Il y en aura six, chaque fois un très bref moment du Quatuor à cordes op. 1 de György Kurtág par le Quatuor Keller. En même temps, je le fais à la mémoire de Márta Kurtág, récemment disparue, et je le fais juste comme de brefs rappels de ceci : que seule la musique fait entendre ce qu’on ne peut pas dire d’elle.)
En parlant de sens musical, comme je l’ai fait pour intituler cette rencontre, on est déjà dans une ambivalence. Ou bien il s’agit de ce que la traduction française nomme le sens musical pour traduire le titre du livre de John Blacking, How Musical Is Man2, paru en 1973, dans lequel il s’agit du sens pour la musique, partagé par toutes les cultures humaines. Ou bien, au contraire, il s’agit du sens que la musique peut avoir ou communiquer, de sa ou de ses possibles significations, question sur laquelle on peut lire, comme vous le savez, des bibliothèques entières. Je voudrais faire remarquer que ces deux acceptions ne peuvent que tendre l’une vers l’autre. Si les hommes ont un sens pour la musique, pour la produire et la recevoir, il faut bien que ce soit parce qu’elle fait du sens pour eux et ce sens de la musique ne peut que répondre, d’une manière ou d’une autre, au sens pour la musique. Un sens est sensible ou il n’est pas, c’est un axiome vraiment simple. Un sens intelligible — une signification — est lui-même toujours sensible. John Blacking dit cela à sa manière pour expliquer ce qu’il a appris par la vie musicale des cultures africaines. Je le cite : « Toute matière est une manifestation de l’esprit ; en jouant, en permettant au corps de se soumettre à l’acte musical, on éprouve de l’empathie avec autrui, avec la nature. C’est une vérité mystique. L’idée de possession se retrouve en un sens dans l’univers musical de l’Occident : jouer Chopin et vivre l’esprit de Chopin. »3
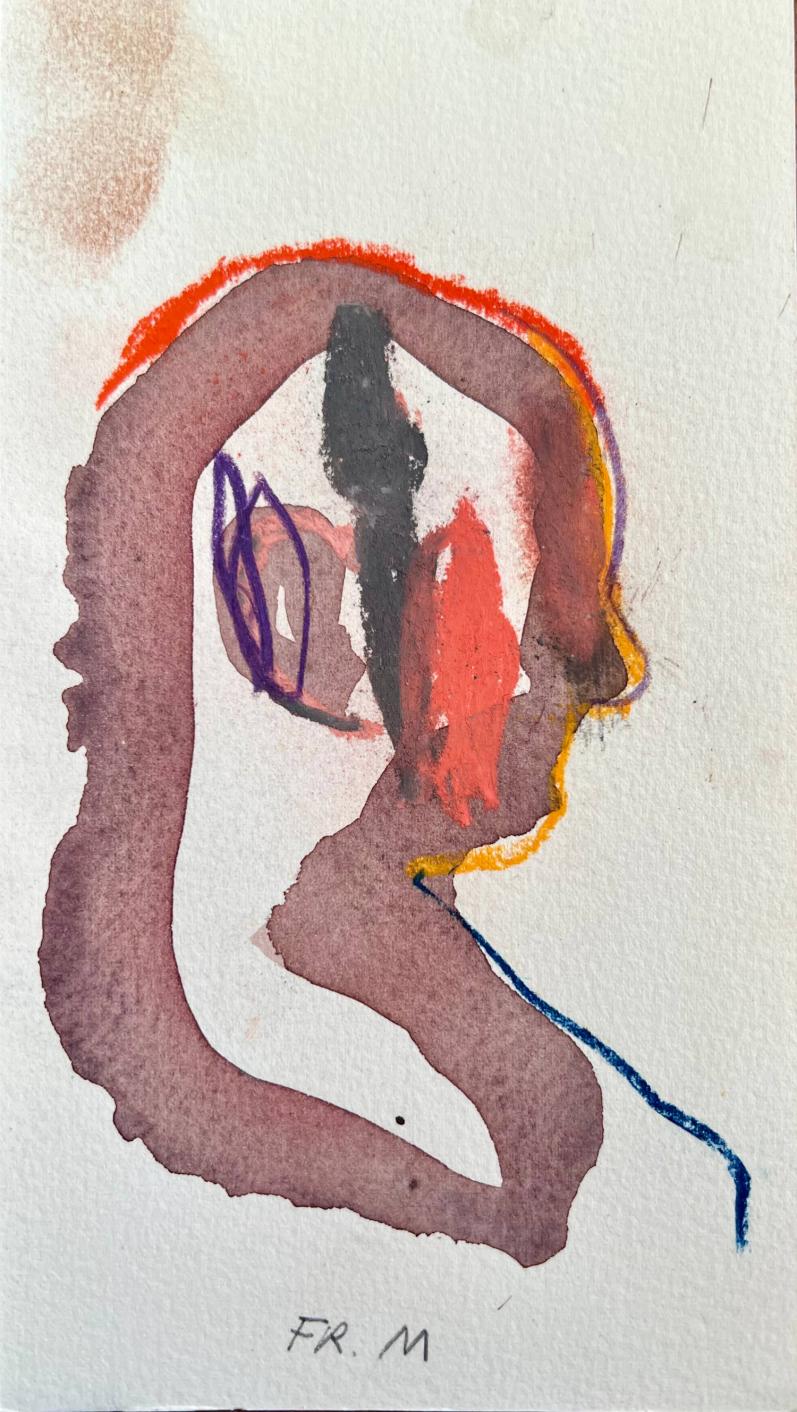 — Portrait de Jean-Luc Nancy
-
© François Martin
— Portrait de Jean-Luc Nancy
-
© François Martin
On peut se méfier bien sûr de mots comme « empathie », « possession », « mystique », c’est une affaire de mots. Qu’il y ait, en revanche, une expérience physique, sensible, de la musicalité, cela ne se discute pas. Au fond, nous savons tous indépendamment de nos savoirs ou ignorances musicologiques que la musique se sent. En italien si sente équivaut à « s’entend ». Nous savons que la musique se sent et que cela fait du sens, de l’affect, de l’émotion, de la motion, du pli, ou de la tension, une impression et presque une idée. Il ne s’agit pour moi, ici et maintenant, que de cette sensibilité sans laquelle il n’est pas de musique. Or, comme vous le savez, pour Claude Lévi-Strauss, la musique est « le suprême mystère des sciences de l’homme »4, ce qui veut dire à la fois qu’elle est irréductible au traitement scientifique et qu’elle emporte en elle la vérité dernière de l’homme. Claude Lévi-Strauss a écrit que la musique « c’est le langage moins le sens »5.
Comme toute formule bien frappée, celle-ci est exposée à la question du sens de ses mots. Que signifie chacun de ces termes sans l’autre ? « Langage » indique alors au moins l’adresse, l’envoi vers l’autre — l’autre fût-il en moi-même —, et le renvoi par l’autre — aussi si c’est moi-même —, ne serait-ce que d’un signal de réception. La formule de Lévi-Strauss convient aussi très bien à ce que j’éprouve lorsqu’autour de moi on parle une langue inconnue : je perçois une ambiance sonore, un jeu de sons, de tons, de rythmes et cela n’a aucun sens bien que cela puisse m’évoquer des dispositions affectives. Qu’il y ait une musicalité du langage, c’est-à-dire des langues, chacune pour son compte, c’est ce que les linguistes désignent comme prosodie pour embrasser l’ensemble des traits phonologiques d’une langue : l’accent, le ton, le rythme, le tempo (les linguistes utilisent eux-mêmes le terme musical de tempo), etc. Philippe Lacoue-Labarthe rapproche cette prosodie de ce qu’on connaît de la sensibilité au son de l’enfant in utero et il écrit : « Tout se passe comme si avant de venir au monde on avait déjà dans une mémoire très profonde, si profonde qu’elle est oubliée, l’écoute de quelque chose du langage : “sa musique”. Alors si la musique cherche à imiter quelque chose comme tout art selon les Grecs, ce serait cette chose entendue absolument avant. »6
« Absolument avant », dans cet avant qui se trouve simultanément du côté de la nature et du mythe, du côté de l’espèce et de la communauté, du côté du rapport aussi bien sexuel que langagier et qui par conséquent se prolonge aussi ou s’étend absolument après, qui résonne au-delà ce que nous percevons, mais qui nous fait sentir, sentir cet absolument ailleurs.
Si donc Lévi-Strauss entend le mot « langage » avec cette portée, alors sa phrase veut dire que cet envoi ou cet appel plus qu’initial et son retour, écho, réponse, résonance, en quelque sorte inextinguible, se détache complètement du sens comme signification. Techniquement, on dirait que ce langage se soustrait à ce qu’on appelle chez les linguistes la double articulation, c’est-à-dire la dualité des unités signifiantes et des unités phonétiques différenciantes. Par exemple, je distingue les mots musique et physique grâce aux différences phonétiques mu/phy dont se soutiennent les distinctions sémantiques. Cette différence est étrangère à l’écriture musicale. Le langage comme prosodie serait la musique qui précède en nous le sens, qui l’appelle et qui le dépasse en même temps. Selon un récit kabbalistique, la musique est inventée par le créateur pour persuader l’âme, qui ne veut pas, d’entrer dans le corps de l’homme. Ailleurs dans la tradition védique, le son et la musique instrumentale sont étroitement associés aux origines et aux divinités. La musique semble inévitablement évoquer — et que veut dire évoquer ? Appeler ! — l’archaïque et le lointain. Mais en même temps, elle procède autant du plus élémentaire et du plus matériel. Ce qui est absolument avant ou absolument après relève aussi bien de l’impénétrable matière que de la plus fine pénétration de l’esprit, et c’est aussi ce que suggère John Blacking.
Pensez à une corde de violon, à son matériau, à sa tension, la pression d’un doigt, le contrôle des muscles, des gestes, et en même temps à l’effleurement d’un archer lui-même avec son matériau, sa tension, sa tenue, etc., et à l’échappée d’un son que nous dirions immatériel, mais qui est très matériellement une vibration de l’air, un frémissement, le déplacement d’une compression, et la résonance pourtant en même temps d’une immatérialité cristalline. La sensation d’une palpitation ou d’une pulsion, une émotion qui saisit et qui fait vibrer en vibrant à la fois la matière d’un tympan est ce que Proust nomme « la communication des âmes »7 pour désigner la musique. Et si nous nous méfions de ce mot « âme », si nous nous méfions de ce qu’il aurait de religieux ou d’affecté, nous pouvons nous fier à Proust lui-même pour qui l’âme « n’est pas […] une prison immobile », mais au contraire ce par quoi « on est emporté dans un perpétuel élan pour la dépasser, pour atteindre à l’extérieur le retentissement d’une vibration interne »8. Deux vibrations se rencontreraient, l’une tournée vers l’autre, l’une répondant à l’autre, ou bien il s’agit d’une même vibration qui ébranle mutuellement le dedans et le dehors. Peu importe, ce qui compte avant tout ici, c’est que nous avons affaire de façon essentielle à une mutualité, à une réciprocité, à un battement par lequel il y a envoi et retour, appel et réponse, retentissement, résonance. C’est la sonorité même, parce que le son épouse l’espace, il le parcourt et la durée de ce parcours lui appartient comme une propriété intrinsèque, le son ne se déroule pas dans le temps, il faut dire qu’il se spatiotemporalise selon ses caractéristiques propres : sa fréquence, son timbre, etc. La résonance, c’est-à-dire l’existence même du son, n’est pas autre chose que l’appropriation ou le modelage d’un espace-temps par une vibration déterminée, mais un espace-temps ça veut dire un corps. En se propageant, c’est-à-dire en s’étendant et en durant, le son fait autre chose que présenter telle ou telle sensation, bruit, il configure une présence au monde et une présence de moi au monde. Il ne pénètre pas l’oreille seule mais le corps entier, ses muscles et ses nerfs, et on peut ajouter aussi qu’il pénètre en même temps le corps social ou commun. Du moins est-ce ainsi que nous élaborons, intensifions, et modulons le son lorsque nous sommes dans la musique, que nous l’écoutions, que nous l’interprétions ou que nous la composions. Or, cela même, c’est le sens ou cela fait le sens. Il n’y a de sens que dans un renvoi du sensible à lui-même, le sentant et le senti ne pouvant ni se séparer ni se confondre et la sensation mais aussi bien le sentiment et même le sens intellectuel (le bon sens si vous voulez) n’ayant jamais lieu que dans cette réciprocité d’un émetteur et d’un récepteur, d’un dedans et d’un dehors, d’un même et d’un autre. Comme le dit Georges Bataille : « Il n’est pas de sens pour un seul. »9 J’ajouterais volontiers que la musique est donc la première manifestation de la non-solitude au double sens où elle ouvre un rapport au monde et où elle le fait à plusieurs. Car un seul musicien est déjà deux. Il fait vibrer sa corde ou son tuyau et il l’écoute et il s’écoute. Sa musique s’écoute. Avec l’instrument de musique ou avec la voix traitée comme instrument, l’homme n’utilise pas un moyen, il se prolonge ou se propage bien plutôt lui-même, il s’emporte lui-même, il se fait vibrer au-delà de lui-même. Et c’est ce que dit Günther Anders dans un texte que la Philharmonie va bientôt publier.10
Extrait de l’ouvrage : Jean-Luc Nancy, À la musique, édition établie par Yann Goupil et Peter Szendy, Paris, Éditions de la Philharmonie, coll. « La rue musicale », 2025, p. 205-214.
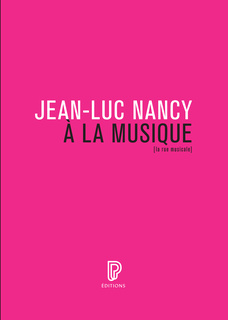
- 1
Conférence prononcée le 21 novembre 2019 à la Philharmonie de Paris, dans le cadre de la série intitulée « Grands témoins ».
- 2
John Blacking, Le Sens musical [1973], traduit de l’anglais par Éric et Marika Blondel, Paris, Minuit, 1980.
- 3
J. Blacking, « Un homme musical : entretien avec John Blacking », propos recueillis par Keith Howard, Cahiers de musiques traditionnelles : « Musique et pouvoirs » 3 (1990), p. 197.
- 4
Claude Lévi-Strauss, Le Cru et le Cuit, Mythologiques I, Paris, Plon, 1964, p. 26.
- 5
C. Lévi-Strauss, L’Homme nu, Paris, Plon, 1971, p. 579.
- 6
Philippe Lacoue-Labarthe, Le Chant des muses : petite conférence sur la musique, Paris, Bayard, 2005, p. 26.
- 7
Marcel Proust, La Prisonnière [1923], À la recherche du temps perdu, Paris, La Pléiade, 1988, vol. 5, p. 762-763 : « Je me demandais si la musique n’était pas l’exemple unique de ce qu’aurait pu être — s’il n’y avait pas eu l’invention du langage, la formation des mots, l’analyse des idées — la communication des âmes. »
- 8
M. Proust, Du côté de chez Swann [1913], À la recherche du temps perdu, Paris, La Pléiade, 1987, vol. 1, p. 85-86 : « Car si on a la sensation d’être toujours entouré de son âme, ce n’est pas comme d’une prison immobile : plutôt on est comme emporté avec elle dans un perpétuel élan pour la dépasser, pour atteindre à l’extérieur, avec une sorte de découragement, entendant toujours autour de soi cette sonorité identique qui n’est pas écho du dehors, mais retentissement d’une vibration interne. »
- 9
Georges Bataille, L’Expérience intérieure [1943], Paris, Gallimard, 1954, p. 55.
- 10
Günther Anders, Phénoménologie de l’écoute, édition établie par Reinhard Ellensohn, préface de Jean-Luc Nancy, traduit de l’allemand par Martin Kaltenecker et Diane Meur, Paris, Éditions de la Philharmonie, 2020.


