Extrait de l’essai historique de Wayne Koestenbaum où se déploie la voix de la folle lyrique, l’opera queen.
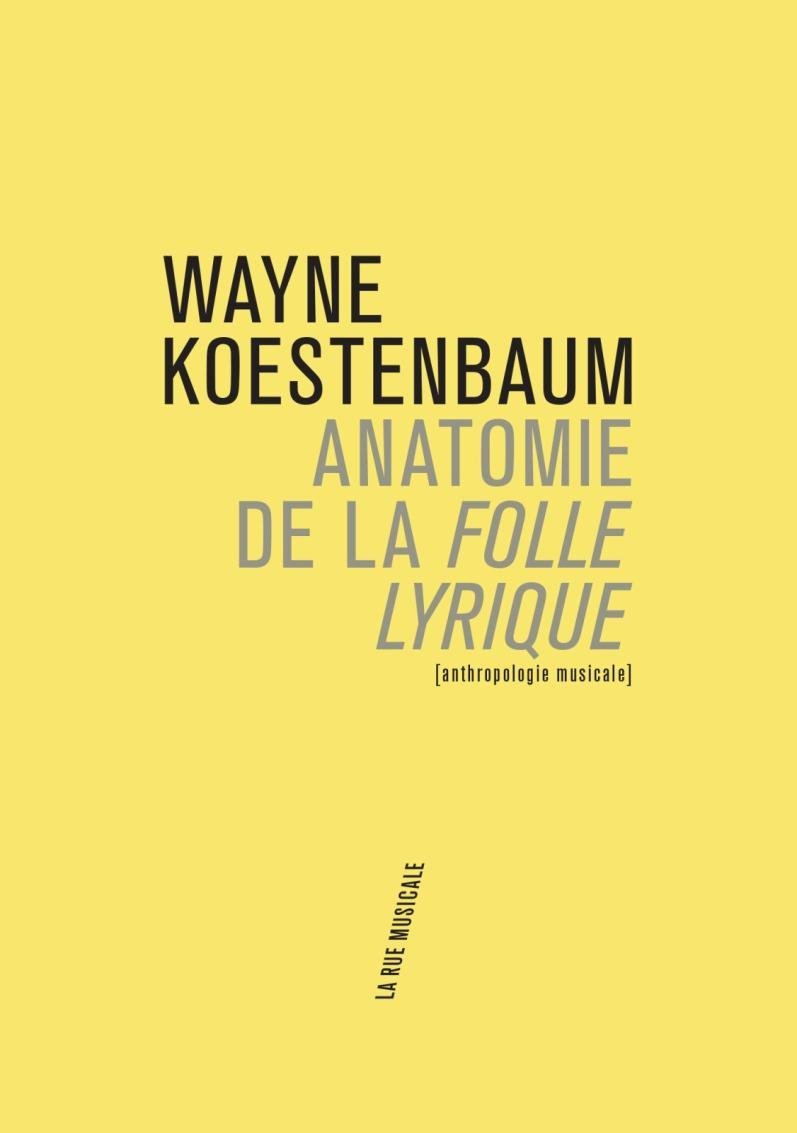 © La Rue musicale
© La Rue musicale
En écoutant Madame Butterfly (1904) de Giacomo Puccini, je participe malgré moi à une histoire d’impérialisme raciste. Pourtant, par moments, l’opéra va à l'encontre de son cadre pernicieux ; la sensiblerie de la musique m’écrase et j’oublie mes réserves. Quand Butterfly fait son entrée, je pars à la dérive, loin de toute position de supériorité ; le nœud coulant du genre se relâche, et je commence à respirer.
Le lieutenant américain Pinkerton, en garnison à Nagasaki, s’est payé une épouse, Butterfly, qui est sur le point d’arriver, et qui m’inspire une certaine impatience : je me suis offert un billet et, en même temps que Pinkerton excité par le désir, j’attends que la présence achetée apparaisse. Mais avant que Butterfly n’entre, ses compagnes en coulisses entonnent un « Ah » agréable et dénué de sens, et parmi une gouache de harpes, Butterfly chante en coulisses « Aspetta » (Attends). Parce que je trouve l’extase par le son et non par la vue, je n’ai pas envie de voir Butterfly ; j’ai envie qu’elle reste en coulisses, entourée par un orchestre qui incarne si entièrement son imminence florale et océanique que je ne prête plus aucune attention à Pinkerton.
Ou bien l’entrée de Butterfly plaît-elle au Pinkerton qui se cache dans l’auditeur ? Non, je peux écouter indépendamment de ses valeurs à lui. Je n’applaudis pas le système impérial de Pinkerton ; j’applaudis les émotions libérées par la voix de Butterfly, émotions auxquelles aucun des mots du livret ne rend justice. Je m’élève au-dessus du rapace Pinkerton (« Ce crétin ne comprend pas Butterfly ») et je m’identifie avec l’exhibition de la diva. Je ressens le coming out ou l’entrée comme des tâches que la puissance accomplit serenamente : la diva doit exercer un rubato de bon goût et s’abstenir de tout effet vulgaire. Elle est censée avoir quinze ans. Elle ruisselle de pathos. Le pathos est suprême parmi les tours que le show-business a dans son sac. Plus tard, elle chantera violemment mais pour l’heure, elle doit soupirer et faire un diminuendo sur un contre-ré bémol (Callas n’y arrive pas).
L’opéra tue ce qu’il aime. Comme Butterfly, si j’entre dans l’opéra, je mourrai, donc je m’attarde à sa limite pour prolonger mon moment d’entrée sans jamais l’achever. J’aspire à rester à l’extérieur du cadre de l’opéra, protégé contre ses charmes dangereux, mais je ressens aussi la séduction du récit : je veux entrer dans l’histoire et je veux que l’intrigue se déroule.
Il est dommage que Butterfly abandonne ses compagnes et monte le décor de colline pour atteindre l’idée que Puccini se faisait d’un climax (et que nous nous en faisons aussi). Combien il aurait mieux valu que Butterfly n’atteigne jamais ce sommet, n’y monte jamais ! Mais nous y perdrions le plaisir de l’opéra ; nous ne trouverions jamais les sons correspondant aux regrets que nous inspire l’accès à la puberté, ce rideau d’arrière-plan peint en trompe-l’œil. Quand l’hétérosexualité se dévoile comme somptueuse et trompeuse, le livret s’effondre, et les savoirs de l’ombre parlent : en aimant l’entrée de Butterfly plus que sa mort, en isolant un moment qui passe trop vite, en rejouant son entrée sur l’électrophone de mon imagination, j’entends Butterfly comme émissaire d’une ambiguïté du sexe et du genre. En écoutant sentimentalement et interminablement, sans me lasser jamais de cette phrase d’entrée, je fais parler une autre Butterfly.
Wayne Koestenbaum, Anatomie de la folle lyrique, La Rue musicale, Cité de la musique-Philharmonie de Paris, 2019, p. 330-332.

Les Éditions de la Philharmonie
Anatomie de la folle lyrique
Dans cet essai qui pense l’association entre opéra et homosexualité, Wayne Koestenbaum donne à entendre la voix de la folle lyrique, homosexuel fou d’opéra.


