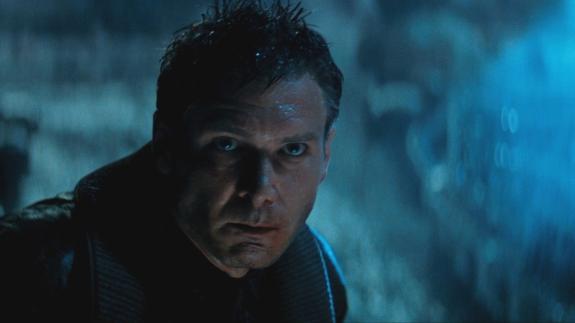Le temps d’un week-end, un riche panorama du jazz made in France, mêlant les styles et les formats. Avec une question à la clé : y a-t-il quelque chose comme un jazz français ?
À quoi reconnaît-on un jazzman français ? Réponse de M. de La Palice : au fait qu’il ne sonne pas comme un américain. Car il y a deux sortes de musiciens de jazz en France : ceux qui essaient de sonner comme leur modèle américain et ceux qui s’obstinent à sonner autrement. Ceux-ci sont des artistes qui n’ont pas inventé quelque chose qui s’appellerait le jazz français, mais une manière française de jouer du jazz. Avec tous ses différents accents. Ils ont donné à cette musique un son propre, un ton qui les rend immédiatement identifiables. C’est la griffe même du jazz. Meilleur exemple, le plus connu et reconnu de par le monde : le Quintette du Hot Club de France de Django Reinhardt et Stéphane Grappelli.
Qu’est-ce que le jazz ? Au départ un folklore local (celui de la communauté noire et créole de Louisiane du début du siècle dernier) qui a réussi en quelques décennies à se propulser hors de ses frontières d’origine pour s’imposer comme un langage aujourd’hui planétaire. Jusqu’à la fin des années 50, les jazzmen français, à quelques rares exceptions près (comme Martial Solal), voulaient tous sonner comme leurs idoles d’outre-Atlantique. Ainsi se condamnaient-ils eux-mêmes à la passion de l’imitation. Le public des amateurs la réclamait d’eux avec insistance et mauvaise foi, tout en leur reprochant de ne pas égaler leurs modèles. Bel exemple d’injonction paradoxale, cette « double contrainte » (“double bind ”) eut pour conséquence de paralyser la créativité de beaucoup de musiciens parmi les plus doués. Résultat : beaucoup furent bloqués dans une identité d’emprunt. Il aura fallu la révolution du free et l’explosion des musiques improvisées européennes à la fin des années 60 pour que ces entraves sautent peu à peu dans leur tête et qu’ils se donnent enfin licence d’oser. Oser quoi ? Oser se délivrer de leur complexe d’infériorité en se fabriquant un son qui soit le leur. Oser faire de cette langue une parole la plus individuelle possible dans un contexte le plus collectif possible.
Depuis ses origines, l’aptitude du jazz à jouer au coucou dans les autres musiques est bien connue. Son histoire mouvementée est celle de ses emprunts répétés à d’autres identités culturelles, de l’Afrique à l’Orient, du musette à la bossa-nova, du rock à la musique contemporaine ou électronique. C’est dans toutes ces rapines et autres opérations de contrebande que le jazz a su donner un sang neuf à son swing et s’inventer ainsi un avenir. Pour preuve, les huit groupes qui vont tout au long de ce Week-end jazz en VF faire entendre leur passion, leur différence et leur travail.
Ce sont toutes des formations originales par rapport à tout ce qui s’entend aujourd’hui dans le monde du jazz « made in France ». Leur musique est pleine d’histoires, avec comme dénominateur commun : le swing, cet alliage inouï de sensualité et d’intelligence rapide. Mais aussi le plaisir de brouiller les pistes en jouant un jazz sans œillères ni frontières. Il faut dire que ces jeunes musiciens, à la différence de leurs aînés, ont tous grandi dans la passion du jazz mais aussi, dans l’amour du rock, de la pop, du hip hop, des musiques du monde et électroniques.
Sur les huit groupes à l’affiche, quatre sont dirigés par une femme. Une parité trop rare dans le monde du jazz pour ne pas être encouragée ! Quatre musiciennes buissonnières, donc, qui aiment créer un univers musical au croisement de plusieurs styles. Voici d’abord la batteuse globe-trotteuse Anne Paceo et son esthétique bigarrée où se mêlent avec bonheur groove pointilliste et pop veloutée, effluves africaines et crescendos psychédéliques, voix blanches et noires ; mais aussi la contrebassiste Sarah Murcia qui, à la tête d’un nouveau quartette Eyeballing, déroule sur des textes de Vic Moan ou Fred Poulet, les paysages d’une pop électro-acoustique des plus singulières ; ensuite Airelle Besson qui, avec sa trompette enchantée, dessine une musique aux couleurs contrastées, tantôt ouatées, feutrées et mélodiques ; enfin la pianiste Eve Risser qui au sein de son White Desert Orchestra, ensemble de dix musiciens, développe une poétique mouvante et émouvante aux confins de la musique de chambre et du post-jazz contemporain.
Les messieurs des quatre autres formations programmées lors de ce week-end « french touch », ne sont pas en reste. Ils n’ont, en matière d’originalité et d’inventivité, rien à envier à leurs consœurs. Pour preuve, le violoniste Théo Ceccaldi qui, au sein de son trio de cordes, revisite avec ferveur et fureur, espièglerie et gourmandise, le jazz manouche de Django Reinhardt. À sa suite, l’accordéoniste aux pieds nus Vincent Peirani, en bon géant du dépliant, propose avec la complicité d’Émile Parisien son nouveau projet qui brasse avec une énergie très rock Led Zeppelin, Sonny Bono et Henry Purcell. Quant au saxophoniste Sylvain Rifflet, avec son quartet Mechanics, il est l’architecte d'une musique envoûtante où la modernité de son jazz post-rock jongle avec les volutes du minimalisme new-yorkais et les boucles des musiques répétitives à la suite de Steve Reich, Moondog ou Philip Glass.
Enfin, last but not least, le saxophoniste Thomas de Pourquery conclura en beauté cette programmation originale en version française en propulsant sa musique extatique qui aborde et absorbe sans vergogne de multiples esthétiques. Mais avec toujours cette pulsation profonde issue de la Great Black Music et, derrière cette pulse, bien sûr, l’Afrique comme source grondante. Son orchestre Supersonic, drôle de vaisseau spatial, sait apprivoiser le chaos, flirter avec l’extase et mélanger, sans entraves de styles et de genres, transe et jouissance, intelligence et truculence, comique et cosmique.