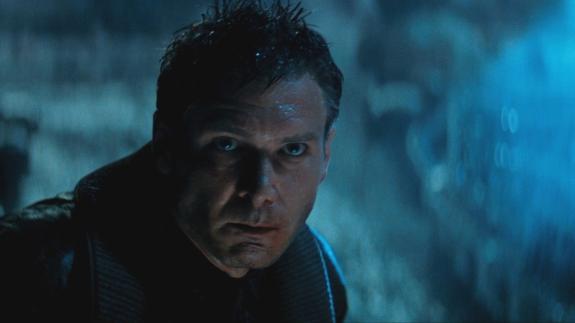Rencontre avec le compositeur de musiques de films Gabriel Yared, créateur de plusieurs bandes très originales qui font déjà partie de la mémoire collective.
« Quand j’écris pour un film, je veux avoir le temps de chercher dans tous les sens, de creuser toutes les directions possibles, au risque de me tromper. Et, en définitive, les morceaux conservés au mixage sont aussi importants que les morceaux non conservés : cela fait partie intégrante du processus de création. On ne peut pas donner à la musique de film la même importance que la musique symphonique si on ne la pratique pas avec la même rigueur et discipline. D’ailleurs, je suis étonné par les compositeurs qui cloisonnent, ceux qui disent écrire d’un côté de la musique pour l’image et, de l’autre, de la musique pour le concert (sous-entendu pour un public plus mélomane et évolué). Au contraire, c’est bien pour le cinéma qu’il faut composer avec la plus grande exigence, dans l’intention d’élever un très large public. » Voilà les mots avec lesquels Gabriel Yared évoque sa conception de l’écriture pour l’image, reflet d’un parcours unique, au contact de cinéastes français, britanniques, italiens, libanais, grecs, égyptiens, américains. Il y a dans sa position une intégrité, une rectitude qui amènent au constat suivant : Yared n’écrit pas par fonction mais par conviction. Pour apporter son éclairage musical, sa lumière à un film, il lui faut un minimum d’affinités avec le metteur en scène, avec le sujet et son traitement. D’où plusieurs partitions fracassantes, fruits d’une vraie chimie humaine et esthétique (avec Beineix, Minghella, Annaud, Dembo, Rappeneau, Ocelot, Leconte, Dolan…). D’où aussi, parfois, des déceptions quand le film ne se révèle pas à la hauteur de ses ambitions. « Lorsqu’il m’est arrivé d’accepter un projet pour de mauvaises raisons, confesse-t-il, la qualité de mon travail s’en est ressentie, fatalement. »
À sa manière, Gabriel Yared ressemble à certains dieux hindous, multiformes. On pourrait presque dire qu’il y a autant de Yared que de films mis en musique par Yared. Cela tient aussi à sa trajectoire personnelle : né à Beyrouth en 1949, il abandonne rapidement ses études de droit pour suivre en auditeur libre les cours d’Henri Dutilleux et de Maurice Ohana à l’École Normale de Paris. C’est à Rio qu’il va ensuite séjourner pendant un an et demi, collaborant notamment avec Ivan Lins, ambassadeur de la bossa moderne. La musique brésilienne l’entraîne dans un torrent de voluptés façon sucré-salé, comme un étrange mariage de soleil et de larmes, rejoignant l’une de ses préoccupations : une ligne de chant claire, qui parle au cœur, aux sentiments, mais troublée par une harmonisation et un contrepoint savants.
À son retour à Paris, en 1973, la chanson le happe : il devient l’un des couturiers vedettes de la variété de l’époque, écrivant les arrangements et dirigeant les séances de Michel Jonasz, Johnny Hallyday, Charles Aznavour, Françoise Hardy et même Francis Lai, pour l’unique incursion de Claude Lelouch dans le western (Un autre homme, une autre chance). Pour Gabriel Yared, l’homme providentiel va s’appeler Jacques Dutronc : le chanteur de « J’aime les filles » le recommande aux metteurs en scène de deux films dans lesquels il fait l’acteur, Jean-Luc Godard pour Sauve qui peut (la vie) et Christian de Chalonge pour Malevil, d’après le roman de Robert Merle. Si l’aventure Malevil s’achève avec désillusion (musique tronquée, escamotée), le face-à-face avec Godard produit de belles fulgurances. « Il ne m’a montré aucune image, ne m’a pas donné de script, à l’exception d’un court synopsis, se souvient Gabriel Yared. On a d’abord longuement parlé, dans un bistrot de Saint-Cloud. Puis, au cours de l’enregistrement, Godard est resté silencieux, réagissant très rarement aux morceaux qu’il découvrait. Il a ensuite monté ses images sur ma musique, non sans pratiquer les coupes drastiques et brutales qui reflètent son point de vue, passionnant, sur la bande sonore. Cette expérience a eu une influence considérable sur mon travail : elle a fait naître en moi l’envie de composer de la musique avant toute chose, en restant au plus près du projet artistique, mais sans chercher à coller à une image précise. La composition hors image, nourrie par la lecture du scénario, par mes discussions avec le metteur en scène, a longtemps été ma méthode préférée. Au fil des années, j’ai mis de l’eau dans mon vin : désormais, dans un deuxième temps, j’affine, je cisèle ma musique en fonction de l’image, de la lumière, du jeu des comédiens, du montage. En fait, j’aime accompagner un projet du début à la fin. »
Sauve qui peut (la vie) va sceller un étrange paradoxe : premier long métrage de Gabriel Yared, dernier de Godard avec musique originale. Voilà la carrière cinématographique de Yared lancée. Mais, à vrai dire, c’est comme s’il avait déjà vécu plusieurs vies. À travers le cinéma, il va simplement trouver le moyen de réaliser la synthèse entre ses différentes cultures. Car tel est le paradoxe de Gabriel Yared : citez Alban Berg, il vous parlera de Marvin Gaye ; évoquez Bobby McFerrin, il vous répondra sur L’Enfant et les Sortilèges.
Le 26 février 1981, Dutronc invite son protégé à diriger en direct deux suites symphoniques, l’une de Sauve qui peut (la vie), l’autre de Malevil, dans Le Grand Échiquier que lui consacre Jacques Chancel. Devant son écran de télévision, le jeune cinéaste Jean-Jacques Beineix, dont le premier long métrage Diva va sortir trois mois plus tard, tombe amoureux de l’écriture de Yared. Ils se rencontrent courant 1982, en amont du tournage à Cinecittà de La Lune dans le caniveau. « J’ai le sentiment d’avoir trouvé l’équivalent avec des notes de mon univers », déclare alors Beineix. Impression confortée par le fait de bénéficier de la partition sur le plateau, du Tango de l’impasse à La Folie des docks, vertigineux ostinato dont Yared déclinera le principe dans Le Talentueux Mr Ripley (Crazy Tom) et Bon voyage (Crazy Fred). Sans parler de la délicate et pudique Valse de Loretta, née de sa rencontre avec Nastassja Kinski. « Écrire la musique d’un film, c’est aussi faire un portrait, souligne-t-il. Ce qui m’est arrivé avec Nastassja mais aussi avec Isabelle Adjani, Juliette Binoche et Angelina Jolie. » Le binôme Yared-Beineix poursuivra sa route avec deux autres opus, dont 37°2 le matin, premier succès discographique à grande échelle du compositeur.
C’est aussi l’époque où Yared renoue avec ses racines, presque à son insu. « Enfant, avoue-t-il, la musique arabe ne m’attirait pas. Au contraire, elle me plongeait dans une infinie tristesse. Je la rejetais, je ne cherchais ni à la comprendre ni à l’assimiler. C’est par et grâce au cinéma que j’ai pris conscience de sa richesse, sur le tard. En réveillant des réminiscences musicales de mon adolescence : le son de la radio qui s’échappe des cafés, l’appel à la prière des muezzins… D’une certaine façon, j’ai replongé dans cette culture en exorcisant mon passé. » À Beyrouth, le jeune Gabriel rêvait de musique occidentale ; à Paris, il fait éclater sa redécouverte de la musique orientale au gré des images d’Hanna K., Les Petites Guerres, Adieu Bonaparte et Azur et Asmar.
En l’espace de quelques années, Gabriel Yared impose sa signature à l’échelle mondiale en multipliant les collaborations avec Bruno Nuytten (Camille Claudel), Robert Altman (Beyond Therapy, Vincent & Theo), Étienne Chatiliez (Tatie Danielle), Jean-Jacques Annaud (L’Amant) et même le tumultueux Jean-Pierre Mocky, le temps de plusieurs bouffonneries hallucinogènes (Les Saisons du plaisir, Une nuit à l’Assemblée nationale) et d’un thriller très maîtrisé (Agent trouble). Inconditionnel de la partition de 37°2, le Britannique Anthony Minghella contacte Gabriel Yared en 1996 pour Le Patient anglais, fresque d’influence leanienne, qui vaudra un Oscar à son compositeur. À l’instar de Maurice Jarre, c’est via l’Angleterre que Gabriel Yared va conquérir les États-Unis. Le tsunami du Patient anglais conditionne son image auprès du public anglo-saxon, celle d’un compositeur d’inspiration romantique ou néoromantique. Étiquette flatteuse (qu’Hollywood va largement exploiter) mais réductrice, ne correspondant pas à la réelle palette de ses capacités. D’autant que ses trois autres longs métrages avec Minghella ne copieront jamais la formule magique du Patient anglais. Ils la contrediront presque, en particulier Par effraction (co-composé avec le groupe pop Underworld) et Le Talentueux Mr Ripley, dont la troublante Lullaby for Cain, au lyrisme ambivalent, s’impose comme l’un des Everest de Yared. « Les paroles écrites par Anthony délivrent un message extrêmement subversif, explique-t-il. “La haine t’a fait tuer ton frère mais dors, mon fils, dors”. C’est une façon de mettre le spectateur sur les rails du sujet mais sans rien en dévoiler. Tout cela a été possible grâce à la confiance de Minghella. Pendant dix ans, il a été le cinéaste qui a su le mieux me pousser vers des chemins inexplorés, puiser au fond de moi des ressources nouvelles. Aucune de nos aventures partagées ne souffre du syndrome de répétition. C’est une leçon que je garde de lui : briser les habitudes, les automatismes, car se répéter, c’est mourir. »
Depuis plusieurs années, Gabriel Yared se fait plus rare, plus sélectif et semble se régénérer auprès d’une nouvelle génération d’auteurs : Cédric Kahn (pourtant réfractaire à la musique originale), Florian Henckel von Donnersmarck (La Vie des autres, co-composé avec Stéphane Moucha), Maïwenn (Le Bal des actrices), Jan Kounen (Coco Chanel et Igor Stravinski), Roschdy Zem (Chocolat), Rupert Everett (The Happy Prince) et Xavier Dolan (Tom à la ferme, Juste la fin du monde, The Death and Life of John F. Donovan), auprès duquel il retrouve une complicité équivalente à celle qui le liait à Anthony Minghella. « Sur notre premier film, souligne le jeune cinéaste québécois, je n’ai jamais rencontré Gabriel. Je n’ai entendu sa voix qu’au téléphone. Mais j’ai rencontré sa musique, son travail et la vaste étendue de son imaginaire. Pour moi, dans le rapport à la musique, cette collaboration a remis les choses en perspective.
Aujourd’hui, les rêves de Gabriel Yared semblent toujours le porter vers la musique de ballet (où il s’est illustré avec Carolyn Carlson, Roland Petit, Wayne McGregor et le Royal Ballet de Londres), l’opéra et les concerts de ses compositions pour l’image, réunissant des solistes du Nouveau Monde. Récemment, son confrère Alexandre Desplat lui a rendu hommage avec une singulière relecture de Camille Claudel pour le Traffic Quintet, retour symbolique au premier traitement de l’ouvrage, pour quatuor à cordes. Après trente-sept ans de mariage avec le cinéma, Gabriel Yared est plus que jamais un compositeur voyageur, un créateur d’une sensibilité à fleur de peau, dont plusieurs bandes très originales font déjà partie de la mémoire collective. Cet hommage à la Philharmonie de Paris est l’occasion d’évoquer librement son rapport à l’image, avec sa part d’interrogations mais aussi son lot de réussites, de convictions. Une possibilité unique d’explorer les innombrables territoires du continent Yared.