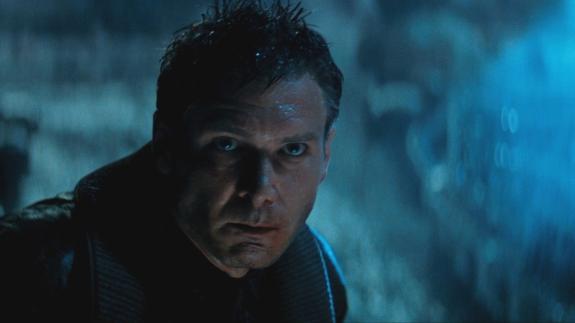La collaboration de Godfrey Reggio et de Philip Glass fut, en 1982, un véritable événement dans l’histoire des rapports entre musique et cinéma.
Très tôt pensés comme devant former une trilogie, avant même la sortie du premier volet, Koyaanisqatsi (1982), Powaqqatsi (1988) et Naqoyqatsi (2002) sont des films dont la singularité et la radicalité ont traversé les années intactes. Ils ne viennent pas de nulle part dans l’histoire du cinéma et partagent notamment avec L’Homme à la caméra (Dziga Vertov, 1929) l’idée d’une narration qui ne reposerait pas sur le dialogue ou sur une histoire mais sur le montage et la musique. Sur le rythme. Ce sont trois documentaires qui disent l’état du monde en images : non seulement parce que c’est le médium le plus à même de toucher les masses, mais aussi parce que le langage, « dans un état de profonde humiliation », y échoue. « Il ne décrit plus le monde dans lequel nous vivons », selon le réalisateur Godfrey Reggio. D’où ces titres, empruntés à la langue des indiens Hopi, mots vierges de tout préjugé. Une image vaut mille mots ? Reggio retourne le proverbe : il lui faut créer mille images pour seulement approcher la puissance des mots Koyaanisqatsi (« la vie en déséquilibre »), Powaqqatsi (« un mode de vie qui consomme les forces de vie d’autres êtres pour prolonger sa propre existence ») et Naqoyqatsi (« la guerre comme mode de vie »).
Parfois taxés de simplisme, ces trois films sont en réalité d’une redoutable complexité, nourrie par le trajet spirituel et intellectuel de Godfrey Reggio, qui non seulement a passé quatorze années de sa vie au sein de l’ordre apostolique des Frères Chrétiens, avant de se diriger vers l’action sociale, mais fut un proche d’Ivan Illich, penseur de l’écologie politique et figure de la critique de la société industrielle, et un lecteur de l’historien Jacques Ellul, de l’économiste et théoricien politique Leopold Kohr ou encore de Guy Debord.
L’épaisseur et la densité des trois films reposent notamment sur le rôle que Godfrey Reggio assigne au spectateur : devant cette profusion d’images, de signes et d’affects, il lui revient de faire sa part du travail, du chemin. C’est d’ailleurs ce travail d’analyse très organique, en temps réel, qui rend les films si pertinents et passionnants encore aujourd’hui. On peut les investir et les lire à la lumière d’événements ou de connaissances qui leur sont postérieurs.
Dans ce cheminement, la musique est un guide. Elle a été composée par Philip Glass en même temps que Godfrey Reggio pensait, créait et ordonnait les images. Elle a imprimé sa marque sur le montage, qui l’a en retour modifiée, en un dialogue peu commun dans l’histoire du cinéma, rendu possible par le temps long sur lequel chacun des trois films a été conçu. Les compositions de Philip Glass répondent à la singularité de chaque volet : Koyaanisqatsi donne à voir l’Amérique au son d’une musique où les synthétiseurs côtoient claviers, cuivres, vents et chœurs ; pour Powaqqatsi, entièrement tourné dans l’hémisphère Sud, Glass a incorporé des sonorités des pays visités, poursuivant ainsi l’ouverture de sa musique au monde, entamée avec Ravi Shankar dès 1966 ; pour Naqoyqatsi, il choisit la composition orchestrale pour contrebalancer la nature abstraite des images. Fil rouge au sein de films complexes, la musique a, comme le rappelle Philip Glass, « cette capacité incroyable de nous dire ce que nous voyons ».