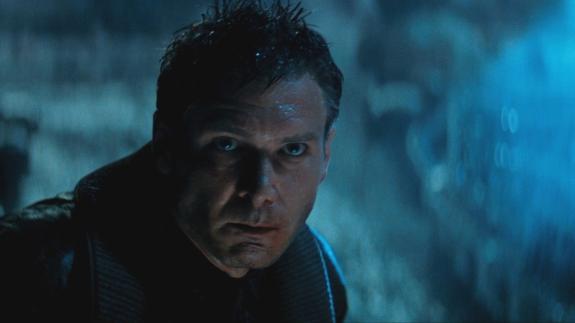Entrez dans l’atelier du compositeur, à la rencontre de sa version d’un mythe intemporel, aux résonances éminemment contemporaines : incarnation de la liberté des femmes, figure de résistance, symbole de transcendance de l’impératif moral sur la loi de la cité. Et découvrez les secrets d’une œuvre pensée pour l’espace unique de la Philharmonie, qui donne à l’Orchestre de Paris le rang de protagoniste à part entière.
Pascal Dusapin présente son opéra Antigone
Publié le 07 octobre 2025 — par Vincent Agrech Lecture 1 min
Qui est Antigone ?
Elle est une métaphore en fait de la conscience morale. Elle est considérée comme le premier exemple moral s'opposant au monde des lois de la société.
Antigone est-elle parmi nous ?
Malheureusement, il n'y a qu'à ouvrir le journal chaque jour. Par exemple, Alexander Navalny, pour moi, c’est une Antigone. Ou cette jeune femme en Iran qui se fait arrêter... La guerre en Ukraine, les morts de Boutcha, le refus de l'inhumation... Ou alors d'une façon, parce qu’Antigone ce n'est pas nécessairement une figure toujours positive : Un djihadiste, c'est une Antigone aussi. Ce qui est intéressant dans le personnage d'Antigone, c'est qu'il n'est pas du tout manichéiste et le personnage est opposé toujours à cet affreux Créon qui est le roi. Mais je ne peux pas dire que j'ai une certaine tendresse pour Créon, mais j'ai une certaine compréhension pour Créon qui est en charge de garder le monde des lois, de la société, de la cohérence de la société en face de quelqu’un qui est le premier exemple dans l'histoire de la pensée, en tout cas, la pensée hellénique, la première femme qui s'oppose à la question de la loi, qui est quand même la question de la survie de la société, enfin en tout cas de la cohérence de la société. Donc Créon va manier la contradiction, certes. Mais il va faire le compromis. Il va essayer d'arranger les choses. Il est tout l'inverse d'Antigone, parce qu’il est obligé de gérer des situations paradoxales, voire antinomiques, mais au nom de la société.
Antigone ne s'intéresse qu'à sa constitution, son édification morale.
Pourquoi avez-vous choisi comme livret la traduction allemande par Hôlderlin de la tragédie de Sophocle ?
Hôlderlin a un point de vue. Il ne change pas l'histoire, mais on sent qu'il pousse quelque chose du côté de Créon. Il arrive à établir une sorte de, non pas d'équivalence, mais en tout cas une équipolence, si j'ose dire, entre les deux personnages, qui fait que même à un moment on se demande : il faut appeler ça Antigone et Créon, ou Antigone à Créon ou Créon à Antigone. Enfin, je me suis posé la question, mais le mythe d'Antigone est monté et c'est de façon certaine en moi en tout cas quand je fais Penthésilée. Donc ça remonte déjà maintenant à quasiment quinze ans.
D’où vient votre goût pour l’opéra ?
C'est par la musique que je me suis intéressé à l'opéra, parce que tout d'un coup, j'ai vu dans ma musique des gestes qui montaient comme ça, des gestes théâtraux. Et c'est comme si l'orchestre, les petits orchestres que j'utilisais alors, montaient comme ça, progressivement sur scène.
Imaginez une clarinette. Vous faites un son très grave comme ça puis après un son très aigu. Vous faites du théâtre ! C'est un geste de théâtre. Dans ces années-là, je suis très proche du théâtre déjà.
Je m'intéresse beaucoup au théâtre, j'y vais beaucoup. J'ai toujours une femme actrice. Je suis resté proche de ça. Je me suis toujours beaucoup intéressé au théâtre. Le théâtre est entré en moi par la musique. Et vous savez, même quand je fais une pièce pour orchestre, je fais du théâtre. Même un quatuor à cordes, je fais du théâtre. Moi, j'ai quelquefois un problème avec les musiques pures. Les compositeurs qui sont dans l'expression comme ça, ultra distingués de l'expression musicale, je les trouve fermés au monde. l'Opéra, ça me permet de rejoindre la psyché humaine. Ça me permet de faire des métaphores. Ça me permet de témoigner d'une vigilance au monde. J'ai souvent dit ça. Quand je fais une Médée en 1991 ,je me souviens, j'ai 35 ans à l'époque, je communique sur la guerre de Bosnie et je dis ce qui se passe d'autre à 1h d'avion de chez nous que cette histoire-là. C’est pour ça que je ne m'intéresse pas aux histoires à l'opéra. Je m'intéresse aux métaphores. Ça ne m'intéresse pas de raconter vraiment une histoire à l'opéra. D'abord, le cinéma fait ça beaucoup mieux que nous. Je dis toujours la même chose. Mais l'opéra, il permet d'exprimer une position, je dirais presque symbolique, où il est clair qu'il s'agit bien de ce monde-là. Qu’est-ce qu'il y a de plus moderne aujourd'hui comme thématique que Antigone ?
D’abord les paroles ou d’abord la musique ?
C'est vrai que j'ai une relation très littéraire en fait à la musique. Je suis toujours porté par un sentiment qui vient de la littérature. La littérature me donne toujours la possibilité d'expression pas seulement complexe... Et tout d'un coup, elle va générer chez moi des formes musicales. Je suis très attentif à la question de la structure dans les livres, les poèmes, les romans, etc. Je regarde toujours comment c'est constitué. Et puis de temps en temps il y a des rencontres qui fait que tout d'un coup, la littérature s'intègre dans la musique. et devient musique. D'ailleurs, un projet comme Passion, par exemple, qui est en fait une sorte d'Orphée que j'ai fait en italien, dont j’ai fait moi-même le texte en italien, procède d'une véritable confusion entre le texte et la musique, parce que le texte s'invente au fur et à mesure de la musique. C'est fait en même temps. C’est-à-dire que quand je commence l'opéra, je n’ai aucune idée de la fin. J'invente le texte au fur et à mesure et en italien en allant chercher des choses chez Monteverdi, chez plein d'auteurs italiens, en inventant des choses moi-même, etc.
C'est comme si le son de l'italien devient consubstantiel même à la musique. Et je vais même jusqu'à un point où la musique, quelquefois prime sur la langue, dans la mesure où je ne respecte pas toujours les accents toniques au bon endroit, des choses comme ça. Mais tout d'un coup, c'est comme si je vois un texte et tout d'un coup ça sonne dans ma tête. Cette rencontre me jette dans l'opéra. Antigone, quand je tombe véritablement amoureux du texte d'Holderlin, c'est parce que je l'entends musicalement. Je le lis comme ça et dans ma tête ça fait des notes quoi. C'est une sorte de kinesthésie bizarre.
Antigone appelle-t-elle une musique dramatique ou intimiste ?
Dans Antigone, il y a juste une flûte comme ça, que je j'isole un peu dans l'orchestre, qui sera d'ailleurs reprise par des haut-parleurs, et qui va chanter un peu à la manière d'une flûte égyptienne, ou avec l'idée que quelque chose vient de l'autre rive. C'est un moment très très doux. Ce n'est pas du tout un moment d'horreur. Dans les moments d’acmé, quelquefois la musique se referme. Je vous donnerais un autre exemple. Quand je fais Medea en 1991,au moment de la mort des enfants je mets un silence. je ne mets pas des trompettes et des timbales. La musique s'arrête. Il n'y a pas nécessairement une association. D'ailleurs, quand vous avez une grande douleur, vous ne dites rien. En tout cas, la stupéfaction vous incline au silence immédiatement. je veux toujours associer ce sentiment avec la musique. La musique en ce sens est de caractère expressionniste. Je ne fais aucune différence entre l'expression musicale et l'expression textuelle, mais je n'associe pas nécessairement la violence d'un texte à la violence sonore, bien au contraire. Quelquefois, au contraire, j'ai tendance même à faire tout tomber, descendre, descendre, descendre. Ce qui fait que ma musique oscille toujours entre des choses quelquefois extrêmement intimes, petites d'expression, presque chambriste, et des moments. de très grands effets sonores, un peu à l'instar de ce que nous vivons, nous, quand nous vivons des émotions.
Écrire un opéra pour un auditorium plutôt que pour un théâtre, quelle différence pour le compositeur ?
Moi, ce que j'aime, c'est qu'on va voir l'orchestre. L'orchestre devient le peuple, devient un acteur. On a toujours tendance à mettre l'orchestre en bas. J'aime bien que l'orchestre fasse partie vraiment de la scène. C'est tellement beau un orchestre qui joue et il peut être mis en scène lui-même. Il devient partie prenante et donc ça concentre tous les objectifs et en même temps ça les maximalise tout en minimalisant les moyens de production. C'est sûr que à la Philharmonie, on n'a pas les cintres qu'on a à l'Opéra de Paris ou ailleurs. Donc il va falloir inventer avec ça. On l'a vu avec Olivier Mantei quand il s'est agi de trouver un ou une metteuse en scène. J’avais l'intuition qu'il fallait une femme pour monter ça. On a donc cherché des femmes et on a eu des retours avec des grandes dames de la mise en scène... J’étais très déçu parce que c'était très académique. “Ah il n'y a pas de fosse, il n'y a pas de cintre, je ne peux pas...” etc. Netia Jones est arrivée. Elle a dit “C'est quoi le job ?” Elle n’a fait aucune réflexion sur le dispositif. Ça n'a rien changé pour elle. Elle se dit bon voilà, on est là, il faut faire quelque chose avec ça, faisons-le ! Donc on va on va voir. Mais je suis très confiant. Le projet de la Philharmonie, en fait, ne change pas les choses en termes de volonté. Il s'agit de faire représentation. Ça ne change pas l'intention. Mais ce que j'ai aimé, c'est la nudité que ça implique, la réduction des moyens, le minimalisme, encore que c’est un minimalisme très luxueux. Il y a quand même 80 musiciens, sept solistes internationaux de premier plan et une metteuse en scène, Netia Jones,
qui est une grande valeur de la mise en scène internationale aujourd'hui. Mais en même temps, quelque chose relève d'un pari que je trouve assez juste, très éloigné des fastes de l'opéra traditionnel. Je pense que c'est une question très moderne. Il faut se poser cette question-là parce que les mises en scène telles qu'on les voit aujourd'hui, que ce soit à l'Opéra de Paris dont je sors avec le Viaggio dont je suis très très heureux, mais quelque part je me dis... Combien de temps va-t-on continuer à faire des choses aussi fastueuses, aussi chères aussi ?
Écrire un opéra pour l’Orchestre de Paris dont le répertoire est majoritairement symphonique, qu’est-ce que cela change ?
Il faut peut-être se poser cette question-là pour arriver à une expression plus concentrée. Donc j'aime beaucoup le projet à la Philharmonie parce qu'il se concentre sur l'essentialité. On n'écrit pas pour un orchestre de fosse comme on écrit pour un orchestre en formation symphonique. Un orchestre de fosse n'est jamais disposé dans les modalités traditionnelles, avec ses panneaux de cordes, de vents qui se succèdent comme ça. Dans les fosses, ça peut être très perturbant avec les cors à gauche, les trompettes à droite, les contrebasses ici et les violoncelles là. Il faut quelquefois organiser les fosses. Ça change un peu le mental. Tous les opéras que j'ai fait pour des scènes d'opéra, je me renseigne très vite. Il y a des fosses on peut en mettre cent et puis des fosses où on peut en mettre 60 ou 70 au maximum. Si on a des percussions, il faut savoir où on les met, etc. Donc je me renseigne toujours sur la disposition finale pour savoir si mes violons vont sonner à gauche ou à droite. J'exagère un peu, mais on n'en est pas loin, parce que la représentation mentale d'un orchestre, la perspective, la profondeur de champ acoustique d'un orchestre sur une scène symphonique, ce n'est pas du tout la même. Or, là, je me suis dit : là, je peux y aller, là, je peux vraiment être dans la fonction qui est dans ma tête, c'est-à-dire les cuivres, là et là, derrière tous les panneaux qu'on connaît dans la disposition symphonique. Alors, ça, ça a changé
probablement par devers moi, l'écriture. Même si maintenant je sais qu'il y a déjà une production en Allemagne qui va se faire dans une configuration disons opératique, traditionnelle, et qui supposera peut-être qu'il faudra réguler des intensités. Mais ça on en a l'habitude. Le mezzo-forte n'est pas une valeur absolue, comme vous le savez.
Choisit-on les chanteurs différemment pour la Philharmonie ?
Dans ce projet, il y a des chanteurs que je connais, d'autres que je ne connais pas encore mais dont j'ai fait le casting avec la Philharmonie en fonction de ces desideratas. Par exemple Jarrett Ott, qui va faire le messager, m'a fait un merveilleux Macbeth. Christel Loetzsch qui a chanté maintenant quatre de mes opéras, dont je connais chaque note. J'ai vraiment écrit le rôle d'Antigone pour elle, c'est sûr, mais au-delà de ça... Où met-on les chanteurs dans une philharmonie ? On les met devant l'orchestre, ce qui pose des problèmes de direction parce que ça veut dire qu’ils sont derrière le chef, ou on les met derrière l'orchestre, ce qui pose des problèmes acoustiques qu'il faut régler avec la technologie d'aujourd'hui. Et ça, je n'ai pas du tout peur de ça. Je pense qu’il faut absolument envisager ça au profit du projet entier. Donc là je sais qu’ils seront derrière l'orchestre.
Quel est le déclencheur de cette production avec l’Orchestre de Paris à la Philharmonie de Paris ?
Alors il se passe tout simplement que Penthésilée est programmé à la Philharmonie en version de concert. J'ai toujours adoré les versions de concert de mes opéras, j'ai toujours aimé ça. Je trouve qu'il y a une liberté tout à coup, même si j'adore l'opéra, la scène. J'aime beaucoup les versions de concert, pas exclusivement de mes opéras d'ailleurs. En fait on était dans une posture concertante. Arrive le confinement, donc tout est annulé. C'était vraiment pour moi un choc. Je m'y attendais et on a été tous au même point. C'était le deuxième confinement. J'avais eu aussi d'autres choses comme tout le monde. Enfin on avait tous vécu la même histoire, mais ça a été une grande peine pour moi, vraiment. Et Laurent Bayle, qui était le directeur à ce moment-là, en quatre semaines arrive à tordre ce projet concertant en un projet filmé à la Philharmonie. Je dois dire que j'en ai gardé un souvenir...d'une émotion considérable. Outre le fait que Laurent a accompli ce prodige de tout transformer en un projet Arte, j'ai été très ému par l'enthousiasme des musiciens de l'Orchestre de Paris, des chœurs Accentus et de tous les solistes qui sont venus et qui étaient d'ailleurs dans une forme extraordinaire parce qu'ils ne chantaient pas depuis des mois et des mois. Et tout ça s'est fait en cinq jours. La réalisation a été extraordinaire. L'impact sur moi en termes émotionnels a été absolument considérable. Quand Olivier Mantei très peu de temps après me dit :“Tu sais, Pascal », parce qu'on se connaît depuis tellement longtemps, « ce serait bien qu'on pense quelque chose, parce qu'il était en train de monter son projet qu'on connaît. Et moi je dis : “Je sais ce qu'il faut faire.” J'avais déjà en tête ce projet, donc je lui présente ce projet et voilà où on en est aujourd'hui.