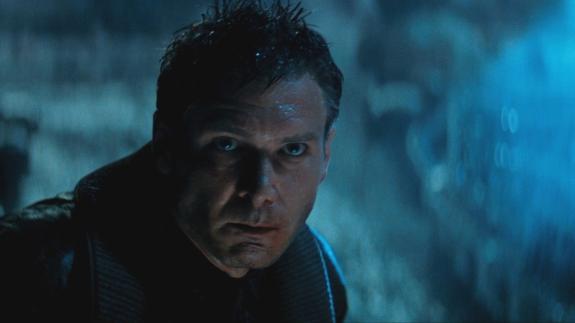La plupart des auteurs, et je fais partie de ces auteurs-là, écrivent des livres qu'ils ont envie de lire. Et, évidemment, écrire sur les musiques nées de l'esclavage, et donc sur ces peuples et donc sur ces sociétés, et donc sur ces identités, parce que c'est aussi la mienne, c'est une évidence : parce que ça, on ne l'a pas, on ne l'avait pas, on ne le connaissait pas. Il faut bien réaliser que dans une société afrodescendante, dont une grande partie de la population descend d'esclaves, est descendante d'esclaves, le récit collectif est extraordinairement difficile, parfois même impossible, parce qu'on veut à la fois cacher, oublier, dissimuler, transcender, soigner cette histoire effroyable de l'esclavage. Et en même temps, on est dans une pulsion de vie, on est dans une pulsion de rapport au monde. Et donc, on a envie de parler de sa culture comme "les autres" parlent de leur culture : comme les Européens parlent de leur culture, comme les États-Uniens parlent de leur culture, de dire "toutes ces musiques se ressemblent" : elles viennent du même endroit, elles viennent du même creuset, elles viennent de la même histoire. Rassemblons-les. Sur les esclaves, sur l'esclavage, sur la naissance de ces sociétés dans lesquelles il y a des esclaves, mais pas seulement : il y a aussi des maîtres, il y a aussi des géreurs, il y a aussi des contremaîtres, il y a aussi des commerçants, des militaires, des marins… Ces sociétés-là n'ont quasiment pas de mémoire administrative et extrêmement peu de mémoire "classique", c'est-à-dire écrite par des historiens, par des journalistes, par des voyageurs… On a très très peu de choses. C'est extraordinairement lacunaire.
Et c'est pour ça que les poètes se sont engouffrés dans cette histoire lacunaire, mais aussi dans cette mémoire indicible. C'est-à-dire que, quand on est armé d'Alfred de Vigny, de Victor Hugo et de Baudelaire, ce n'est pas très difficile de raconter les émotions d'un Français du XXe siècle. Ça, ce n'est pas difficile, ce n'est pas très compliqué. Et Aragon lui-même, et Prévert lui même, l'ont dit : il ne leur est pas difficile, compliqué, de raconter leur monde. Mais, quand on est un jeune Aimé Césaire de 19 ans, quand on est un jeune Édouard glissant de 20 ans, comment fait-on ? Comment fait-on pour dire ce que l'on est sans cette mémoire écrite, sans cette mémoire transmise par l'école, par les mémoires familiales, comment on fait ? Et c'est pour ça qu'ils ont forgé les noms : créolité, créolie, créolisation, négritude, batarsité… Tous ces mots-là ont été forgés par les poètes. Et cette "vision prophétique du passé" comme dit Édouard Glissant, cette "vision prophétique du passé", elle est parce que les historiens, parce que les sciences humaines, n'ont pas dit le passé. Pas assez. Il y a des textes mais pas assez.
Sur les musiques créoles… Je sais qu'il y a toute une partie de la musique enregistrée qui a plus ou moins disparu ou qui est à peu près introuvable, qui est chez quelques collectionneurs ou pire encore chez des gens qui ont des disques chez eux, sans pour autant les collectionner, sans avoir envie de faire archive, mais il y a une quantité énorme de musique qui n'a pas été enregistrée. Il y a des genres entiers, des genres qui sont décrits par des voyageurs, qui sont décrits par des mémorialistes, qui sont décrits par des journalistes, sur lesquels on n'a aucun enregistrement. On n'a rien. Rien n'a été enregistré. Et c'est assez désespérant parce que quand on travaille sur l'histoire d'une musique, ne pas avoir de sources enregistrées, c'est réellement exaspérant.
Mais globalement, il y a un bagage actuellement enregistré et disponible qui est gigantesque, mais c'est un des quelques domaines dans lequel il faut aller fouiller. Les services de streaming par abonnement sont extrêmement pauvres en musique créole, extraordinairement pauvres. Les catalogues de CD actuellement disponibles dans les grands magasins, dans les grandes surfaces spécialisées… sont extrêmement pauvre. Donc, il y a vraiment tout un travail de réévaluation, de réédition à faire. C'est pour ça que dans le livre, je n'ai pas mis de discographie parce que cette discographie est absolument impossible pour l'instant. Certaines des sources disponibles sont totalement illégales. C'est-à-dire qu'il y a des gens qui ont mis en ligne, sans autorisation, sans droit de le faire, sans sans rien qui soit acceptable du point de vue juridique et même du point de vue du droit d'auteur, mais qui sont des ressources absolument gigantesques, phénoménales, qui sont mises en ligne par des passionnés.
Donc, ce qui est assez curieux, c'est qu'on se retrouve aujourd'hui, quand on travaille sur ces musiques, on se retrouve dans une situation de digger. On se retrouve vraiment dans une situation d'explorateur des musiques, qui fouille sur internet, à la recherche de ressources. Heureusement, on les trouve. Ce n'est pas trop, trop, trop difficile de retrouver ces sources, mais c'est extraordinairement frustrant. Et ça en dit beaucoup aussi du regard sur ces cultures. On est dans des cultures populaires lacunaires. Et ces cultures lacunaires vont se mélanger dans une volonté, un, de survie ; deux, quelque chose qui est difficile à accepter quand on parle d'un crime contre l'humanité, de divertissement. C'est-à-dire que oui, on s'amuse. Oui, c'est une tragédie. Oui, c'est un monde effroyable dans lequel un petit nombre d'humains a droit de vie et de mort sur un grand nombre d'humains. C'est effroyable. Sauf que ça dure trois siècles et demi, sauf que ce n'est pas un moment, une parenthèse, dans l'histoire de ces personnes, c'est leur vie, c'est leur vie entière.
La plupart des possesseurs d'esclaves, dans l'histoire, sont les fils de possesseurs d'esclaves. Donc pour eux, il est presque absurde, obscène, inouï, d'imaginer que les esclaves puissent être des hommes comme les autres et donc libérés, avoir les mêmes droits qu'eux. Et donc ça va donner, pour parler de musiques qui apparaissent au XXe siècle, ça va donner la biguine, ça va donner le zouk, ça va donner le compas, ça va donner la cadence, ça va donner la cadence lypso, ça va donner le reggae, ça va donner toutes ces musiques qui, plus ou moins, vont faire nos samedis soir. C'est-à-dire que ces musiques sont passionnantes, non pas parce qu'elles sont passionnantes pour ces sociétés, mais parce qu'elles sont passionnantes pour l'Occident, parce qu'elles sont passionnantes pour le monde entier.
Et le monde créole a fourni au monde présent, à la mondialisation présente, sa musique. Ce que chante, ce que joue Beyoncé, Major Lazer, ou n'importe quelle star mondiale aujourd'hui, a à voir avec la créolité. Et c'est pour ça qu'essayer de comprendre comment ces musiques se construisent est sans doute extrêmement important pour comprendre pourquoi nous écoutons ce que nous écoutons aujourd'hui. Et donc, ce sont des musiques qui sont, comme les langues créoles, des musiques partagées entre maîtres et esclaves, par des dispositifs sociaux extraordinairement complexes, avec des dispositifs, des ressorts psychosociaux réellement compliqués. C'est-à-dire que l'on peut être le maître d'un esclave, avoir droit de vie ou de mort sur l'esclave et exercer ce droit de vie et de mort – parce que ça existe aussi des esclaves assassinés, suppliciés, tués par décision de justice… Mais ça n'empêche ni le maître, ni le juge, ni le contremaître, ni le policier d'avoir de l'admiration pour la musique de l'esclave. Et les esclaves peuvent vivre une situation totalement effroyable, dans des situations indicibles, avec une espérance de vie qui est inférieure à 30 ans, pour un adulte esclave né sur un territoire d'esclavage, et pour autant être fascinés par la musique du maître, jouer la musique du maître, s'en emparer, et non seulement s'emparer de sa musique, mais s'emparer de tout ce qui va avec : l'apparat, la sociabilité, une certaine façon de produire un bal, de produire une soirée de danse… Les esclaves qui sont un des symboles les plus ultimes de ce que peut être l'exploitation de l'homme par l'homme, ils peuvent être fascinés par cette culture de la caste blanche des possédants et s'emparer de cette culture là. Donc on est toujours dans une ambiguïté, mais cette ambiguïté, c'est la créolité elle-même.
Les instruments d'aujourd'hui, les techniques d'aujourd'hui, les demandes des sociétés d'aujourd'hui, se retrouvent dans la créolisation. Quand, dans les années 1990, ça commence et puis ça explose vraiment dans les années 2000, et c'est presque dominant aujourd'hui, le poids de l'électronique dans les musiques créoles est complètement décisif. C'est-à-dire que, alors qu'en Europe, aux États-Unis, des gens se penchent sur du matériel très cheap, des boîtes à rythme, des ordinateurs très simples, il se passe la même chose aux Antilles, mais avec un bagage de musique créole et une approche créole, et encore une fois, ce qu'Édouard Glissant appelle le "génie de la créolisation". Donc la naissance du bouyon d'abord, puis la naissance du shatta ensuite, c'est réellement ça. Ce sont des musiques créoles. Et ce sont des musiques qui, quand les écoutent avec un entendement antillais, ce qui n'est pas toujours perceptible par les Européens et notamment par les Français, c'est que ces musiques sont extraordinairement proches dans le tempo du compas et du zouk. Donc elles sont beaucoup plus facilement transgénérationnelles qu'en Europe, que dans les sociétés européennes, et puis surtout, elles ont apporté quelque chose d'assez inattendu : c'est une prise de parole, et parfois même une prise de pouvoir des femmes.
Quelque chose qui est perceptible depuis très, très peu de temps en France européenne, dans le public jeune, est perceptible depuis beaucoup plus longtemps aux Antilles, c'est que soudain, il est apparu des musiques et des genres musicaux qui sont des genres dans lesquels la liberté, l'orgueil, le combat des femmes, s'entend beaucoup plus que dans aucune autre musique créole précédemment. Et là aussi, continuement, ça rappelle que les musiques qui sont des musiques de danse, qui sont des musiques du samedi soir, qui sont des musiques de la séduction, qui sont des musiques de l'hédonisme et de la jouissance, sont aussi des musiques de combat, sont aussi des musiques de résistance. Toujours, systématiquement, y compris aujourd'hui.
La nécessité de disposer d’un récit de ses origines et de son parcours dans le temps ne s’impose pas avec la même urgence chez les peuples du « nouveau » monde et chez ceux de l’Europe. Les sociétés que les puissances coloniales ont établies au loin en recourant à la traite négrière souffrent de lacunes du savoir que ne connaissent pas les nations européennes, qui disposent de colossales archives exploitées par des générations de clercs.
Là où les sources manquent, peut s’imposer la « vision prophétique du passé » dont use Édouard Glissant pour bâtir la compréhension de sa terre natale. De fait, les réalités qu’aborde ce livre — à défaut d’un savoir institué — ont été nommées par des poètes. Créolité, créolisation, négritude, créolie, antillanité, réunionnité, batarsité : en forgeant ces mots, ils ont ouvert la voie à un courant de la recherche dans lequel nous nous inscrivons.
Cet ouvrage ne revendique pas les presciences et les intuitions des poètes dessinant le génie de la créolité, mais il ne peut toujours cheminer avec la tranquille rigueur que permet l’opulence documentaire concernant tous les sujets d’histoire culturelle de la France. Car nous parlerons ici d’un monde peu écrit, mal archivé. L’inconséquence des administrateurs, l’intérêt intermittent des « métropoles », les hargnes de la guerre et de l’émeute ont pour complices l’humidité, les invertébrés, les moisissures rongeant le papier qui a eu la chance d’échapper aux pluies des ouragans ou au feu des volcans.
Nous parlerons d’un monde dont une grande partie des humains qui l’ont peuplé ont constitué un bétail, puisque tel était l’usage fait des personnes esclavagisées. Et nulle civilisation n’a cherché à conserver la mémoire des noms, des émotions, des paroles ou des gloires du bétail.
Nous parlerons d’un monde que la langue de Paris n’a pas souvent su décrire autrement qu’avec les mots du lointain, de l’altérité, de l’indéfinition. Certes, le mot « outre-mer » n’est pas toujours synonyme de « nègre », mais il trace la même géographie…
Donc, en explorant la genèse et les mutations des musiques nées pendant les siècles d’esclavage puis dans les sociétés que celui-ci a modelées — directement dans le « nouveau » monde, ou plus subtilement dans la France européenne —, nous parlerons de réalités historiques, culturelles, commerciales ou politiques éparpillées dans le temps et dans l’espace, convergeant et divergeant selon des logiques parfois difficilement lisibles. Cette histoire reste encore à écrire d’une manière globale et, souvent, nous devons pour notre étude compiler des sources disparates, voire dangereusement disjointes. Nous jetons donc des ponts entre territoires, mais aussi entre disciplines, entre sujets, entre corpus, avec le sentiment d’ouvrir çà et là des voies nouvelles, courant l’inévitable risque qu’elles surprennent en élargissant le territoire mental des représentations des musiques de la créolité. Mais comment procéder autrement quand on sait l’enchevêtrement de lignes et de logiques historiques sur des dizaines de territoires pendant plusieurs siècles, avec comme seul lien général, dans le temps comme dans l’espace, la pratique de l’esclavage ? Et cette pratique dure suffisamment longtemps et avec assez de prégnance sur l’économie, les questions internationales, les phénomènes religieux et évidemment toutes les relations sociales, pour que naissent de nouvelles sociétés dans le « nouveau » monde.
Aussi faisons-nous confiance aux chercheurs qui, penchés sur des objets d’étude très partiels, polissent chacun quelques pièces de la vaste mosaïque que nous tentons de reconstituer, aux voyageurs, journalistes et mémorialistes décrivant des terres et des peuples qui leur semblent mériter de l’être, aux romanciers et novellistes forgeant de nouvelles littératures1. Il restera des angles morts, des ombres, des oublis dans cette perspective embrassant des entreprises coloniales éparpillées sur plusieurs océans et plusieurs siècles mais unifiées par la langue et le bagage culturel commun des Français — unies aussi par la diversité, l’hétérogénéité, l’instabilité, l’incohérence des projets politiques, religieux, économiques portés sous le changeant drapeau de ce pays.
Il nous faut quêter le savoir à des sources hétéroclites et partielles, à commencer par le corpus vertigineux mais toujours lacunaire des musiques créoles enregistrées, soumises plus que d’autres formes populaires aux fragilités des filières musicales locales et des entreprises publiques ou privées de conservation de ces patrimoines. Il s’y ajoute des milliers de concerts sur divers territoires, la fréquentation de nombreux artistes et professionnels de ces musiques et — tout simplement — quelques décennies de passion opiniâtre pour la musique.
Inévitablement, la subjectivité de l’auteur de ce livre sera plus largement nourrie par son propre parcours de vie que s’il s’agissait d’une thématique culturelle hexagonale bénéficiant de sources d’une abondance et d’une qualité sans commune mesure avec ce qui existe pour le domaine de l’esclavage français. Ainsi, certains sujets seront abordés en assumant que l’auteur n’est pas un Français originaire de la seule Europe. Il est possible que cela ne soit pas flagrant pour le lecteur, à part quelques choix transparents d’orthotypographie ou dans l’emploi massif de termes créoles — en respectant l’absence de marque écrite du pluriel, en acceptant des graphies très différentes du français courant pour une prononciation identique.
L’essentiel n’est pas là. Il réside dans une insistante interrogation historique de moins en moins implicite dans l’étude de ces cultures. D’une part, que signifie pour une nation d’avoir été esclavagiste, notamment lorsqu’elle doit accepter que Caliban chante, danse et semble rire ? Autrement dit, la perception de la tragédie de la traite esclavagiste transpire-t-elle toujours sous la popularité de « musiques du soleil » ? D’autre part, la distinction entre les races peut-elle être estompée dans une société convaincue d’entendre distinctement l’incarnation d’une pure africanité dans certaines formes musicales appelées « musiques noires » ? Et cet essentialisme n’exprime-t-il pas la continuité idéologique des certitudes qui fondèrent plusieurs siècles de légalité de l’esclavage ?
- 1
Les références bibliographiques sont rassemblées en fin d'ouvrage, pour son ensemble et pour chaque chapitre. Nous soulignons seulement, dans le cours du texte, quelques auteurs et quelques travaux décisifs pour la compréhension du sujet.