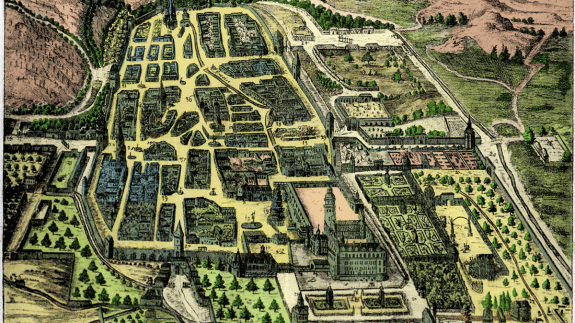Écouter ce podcast sur Apple Podcasts, Deezer, Google Podcasts ou Spotify.
Souvenons-nous :
Entre 1717 et 1722, Johann Sebastian Bach a passé des années particulièrement intenses à Köthen, pour sa vie personnelle comme pour sa carrière. Auprès du prince Léopold, il a bénéficié d’une confiance et de moyens exceptionnels pour sa musique. Mais alors, pourquoi partir ? Il faut admettre que ces six riches années ont aussi coûté très cher au prince ! Et quand celui-ci se marie, en 1721, sa jeune épouse, peu mélomane, s’emploie à réduire des dépenses qu’elle trouve démesurées. Quand la première coupe sombre se fait sentir dans son ensemble musical, Bach comprend que rien ne sera plus comme avant.
Comme quoi, mariage et musique ne font pas toujours bon ménage…
C’est une page qui se tourne pour Bach. Résolu à quitter Köthen, il prend ses dispositions en demandant une lettre d’accord à Léopold. Il a tiré des leçons de ses mésaventures à Weimar : cette fois-ci, il ne passera pas par la case prison !
Le voici donc en règle, prêt à partir… Mais pour aller où ?
Heureusement pour Bach, le hasard fait bien les choses. Le compositeur Johann Kuhnau, qui occupait le poste de Cantor de l’église Saint-Thomas de Leipzig, décède le 5 juin 1722… une place se libère !
Leipzig, en ce premier quart du XVIIIe siècle, est la deuxième ville de Saxe, bourgeoise et bien portante, avec ses foires de commerce et son université réputée. Mais du côté musical, ce n’est pas vraiment ça : depuis une vingtaine d’années, le niveau des élèves musiciens s’est nettement dégradé. Le conseil de Leipzig est bien décidé à y remédier et pour cela le choix du nouveau Cantor est crucial. L’objectif est de recruter le meilleur compositeur allemand du moment. Tout simplement.
Évidemment, me direz-vous, le meilleur, cela doit être Bach ! Eh bien… non. Pas du tout.
Le premier nom auquel pensent les membres du Conseil, c’est celui de Georg Philipp Telemann. En poste depuis peu à Hambourg, Telemann est le compositeur le plus en vue du moment. Lorsqu’il est contacté par le Conseil, il se rend aussitôt à Leipzig et signe un contrat ! Hourra, on a le meilleur !
Sauf que… rentré à Hambourg, Telemann s’empresse d’aller voir son employeur pour lui faire part de la situation et pour renégocier son contrat. On ne veut pas qu’il parte ? Eh bien, qu’on augmente son salaire et qu’on lui donne le loisir de composer des opéras ! Ce qu’il obtient. Et Leipzig doit donc se trouver un autre candidat.
Bach, alors ! Eh non, toujours pas.
Comme second choix, le Conseil se tourne vers Christoph Graupner. Établi à Darmstadt, où les moyens mis à sa disposition se réduisent, Graupner est à ce moment-là en recherche d’un nouveau poste. Il est donc très intéressé par l’offre de Leipzig.
Telemann n’avait pas eu à candidater – c’était le meilleur, pas besoin de le mettre à l’épreuve – mais pour Graupner, la situation est sensiblement différente. On lui demande donc de venir auditionner avec deux cantates qu’il joue dans l’église Saint-Thomas.
Ces cantates sont magnifiques. Tout le monde est très satisfait : l’audition est réussie ! On se félicite, on se serre la main : l’affaire semble entendue.
Graupner, lui aussi ravi, rentre à Darmstadt pour annoncer son départ. Mais là, les choses ne sont pas si simples : Darmstadt n’est pas une cité libre et, en tant que citoyen de la ville, on lui fait comprendre qu’il ne peut pas se dégager aussi facilement de ses obligations. Si le doyen lui demande de rester à Darmstadt, il doit y rester. Un point c’est tout.
Déçu, Graupner doit donc décliner l’offre de Leipzig.
Mais alors, qui reste-t-il pour prendre le poste de Cantor ?
Bach ? Pas si vite !
À ce stade-ci, les autorités de Leipzig ont de quoi être échaudées. Nous sommes déjà début 1723, soit près d’un an après la mort de Kuhnau : le poste n’est toujours pas pourvu. Les premier et deuxième choix n’étant pas disponibles, il va falloir se plonger dans la liste des candidats de troisième zone. Comme l’écrit l’un des membres du Conseil dans une lettre : « Puisque l’on ne peut avoir les meilleurs, il faut donc prendre les médiocres. » C’est dire l’enthousiasme…
Mais comment se fait-il que Johann Sebastian Bach soit si peu considéré dans cette compétition pour le poste de Leipzig ?
Tout simplement, parce qu’il n’est personne. Il n’a jamais été Kapellmeister : à Köthen, il n’était que Konzertmeister. Surtout, durant ces dernières années il n’a écrit quasiment aucune cantate – alors que c’est précisément ce que l’on attend d’un Cantor. Avec la petite trentaine de cantates à son actif, il fait pâle figure par rapport aux 1 043 de Telemann et aux plus de 1 400 de Graupner !
Il y a aussi une autre raison, qui fait reléguer la candidature de Bach au second plan. Une raison qui n’a rien à voir avec ses compétences, ni même avec son expérience de musicien, mais avec son parcours académique – et donc, d’une certaine manière, son origine sociale…
Bach n’est jamais allé à l’université. Il faut dire qu’il travaille d’arrache-pied depuis ses 18 ans, ce qui n’est pas franchement compatible avec des études supérieures !
Or Leipzig est une grande ville universitaire, et le poste de Cantor implique de donner un enseignement à des jeunes gens éduqués – ce que Telemann et Graupner semblent plus à même de faire, puisqu’ils ont reçu une formation supérieure à Leipzig (Telemann y a étudié le droit et Graupner a fait partie du chœur de l’université).
Dans l’esprit des membres du conseil, Bach est donc un « nobody » mal dégrossi, et surtout, insuffisamment éduqué – il n’appartient clairement pas à la même élite que Telemann ou Graupner !
Et pourtant. À la suite de leur défection, Bach obtient enfin l’opportunité d’auditionner à Leipzig, avec les deux cantates qu’il vient d’écrire à Köthen…
L’audition se passe très bien : ce n’est peut-être pas « le meilleur », mais Bach fera l’affaire !
Johann Sebastian s’empresse de signer son contrat, fait ses bagages et s’installe à Leipzig à peine un mois plus tard, le 22 mai 1723, accompagné de sa petite famille.
Peu de temps après, pour Noël 1723, il fera résonner son Magnificat dans l’église de Saint-Thomas ; puis viendra la Passion selon saint Jean. Là, aucun doute : il mérite bien sa place à Leipzig. Et plus personne n’ira jamais dire le contraire.
En somme : tout est bien qui finit bien !
Pourtant, on ne peut s’empêcher de se demander : que serait-il arrivé si Telemann ou Graupner avait pris le poste de Leipzig ? Quelles auraient été les conséquences, pour Bach bien sûr, mais aussi pour toute l’histoire de la musique ?
À Leipzig, Bach acquiert une liberté, des moyens et des responsabilités qui vont permettre à son génie de se déployer et de prendre sa pleine mesure. Drôle de destin, quand on pense que tout cela n’a tenu qu’à un coup du sort !
Dorénavant, la carrière de Johann Sebastian prend son envol. Il va devenir le grand Johann Sebastian Bach.
Mais ça, c’est une autre histoire !