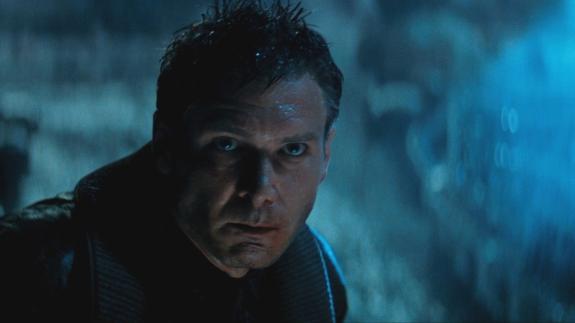Depuis les premières oeuvres pianistiques de l’immédiat après-guerre, le clavier n’a cessé d’accompagner Pierre Boulez dans ses expérimentations, tel un journal de bord.
 — Florent Boffard
-
© JB Millot
— Florent Boffard
-
© JB Millot
1958. Pierre Boulez s’entretient avec Antoine Goléa :
« – Et le piano ? Vous n’en avez pas fait au Conservatoire ?
Un sourire infiniment malicieux éclaire le visage de Boulez, plisse le coin de ses yeux, fait vibrer son nez.
– Non. J’ai été recalé au concours d’entrée… »
Le mouvement de la Sonate en la bémol majeur de Weber a en effet eu raison de sa candidature au Conservatoire de Lyon. C’est donc avec Lionel de Pachmann, le fils de Vladimir (pianiste germano-russe légendaire pour ses interprétations exubérantes de Chopin), que le jeune Pierre, alors âgé de 17 ans, suit à Lyon des cours privés d’harmonie et de piano en 1942-1943. Avec lui, il étudie le répertoire classique : Beethoven, Chopin, Liszt. Si l’on excepte les quelques leçons prises durant son enfance, Pachmann aura été son seul véritable professeur de piano. Une des psalmodies de 1945 est dédiée « à mon cher maître L. de Pachmann, son élève très respectueux et reconnaissant ».
Cet échec à l’entrée du Conservatoire n’a pas empêché le compositeur de devenir un pianiste d’une habileté remarquable, et même un des rares de sa génération capables d’interpréter certaines de ses propres œuvres, pourtant connues pour être particulièrement acrobatiques, ce jusqu’au début des années 1960, avant que la direction d’orchestre ne prenne le pas, et que le piano s’éclipse quelque peu de son horizon de pensée. Antoine Goléa compare Boulez à Bartók. Ainsi crée-t-il lui-même, flanqué de son maître Messiaen, Structure Ia – la première pièce du premier livre des Structures pour deux pianos (1951-1952) à l’écriture rythmique démoniaque (une archive vidéo, disponible sur Internet, le montre en train de répéter avec Yvonne Loriod) –, sa Troisième Sonate pour piano (1956-1957) ou encore le deuxième livre des Structures pour deux pianos (1956-1961), avec Yvonne Loriod de nouveau, extraordinaire interprète au service de la création musicale.
Boulez se distingue ainsi au sein d’un xxe siècle musical qui, en repoussant à chaque nouvelle œuvre les limites de ce qu’il est techniquement et physiquement possible de faire faire à un instrument et à son interprète, signe la fin de la figure du compositeur-instrumentiste, et ce faisant du piano en tant qu’espace de projection sonore de l’intériorité musicale du créateur, comme le conçut ce xIxe siècle romantique tout d’inventions formelles et d’épanchements de l’âme – l’artiste composant au piano et faisant découvrir à une poignée d’élus les effervescences de son imagination… Certes, en 2010, Boulez confiait à François Meïmoun combien il aimait improviser au piano lorsqu’il avait 20 ans, et combien fondamentale était pour lui la relation amoureuse que Messiaen entretenait avec son piano dans sa classe d’harmonie et d’analyse, à l’inverse, tenait-il à préciser, de Leibowitz, qui « était au piano mais il ne jouait pas ».
 — Simon van Boxtel
-
© S.Boxtel
— Simon van Boxtel
-
© S.Boxtel
Questionner la tradition
Ses premières œuvres – Variations pour piano main gauche, Prélude, Toccata et Scherzo, Trois Psalmodies, Douze Notations, toutes composées en 1944-1945 – conservent ainsi l’empreinte du geste d’improvisation fixé sur la partition. Ce geste caractérise l’écriture de Jolivet et de Messiaen, dont l’influence sur le jeune Boulez est forte à cette époque, comme le sera la rupture d’ailleurs… définitive avec Jolivet (l’incident du « joli navet » de 1958 au Domaine Musical est mémorable), provisoire avec Messiaen. À l’exception des Douze Notations, réhabilitées quarante ans après leur composition suite à leur flamboyante métamorphose orchestrale (Notations I à IV en 1980 et Notation VII en 1997), l’absence de ces pièces au catalogue des œuvres de leur auteur est significative, autant qu’est essentielle leur (re)découverte au point de vue musicographique. Car cette mise au jour permet de saisir la pensée en devenir d’un compositeur durant sa si brève période de formation. Œuvres de jeunesse comprenant des traits stylistiques vite abandonnés pour leur attachement trop identifiable à des maîtres ou au monde d’avant, elles manifestent cependant déjà une réelle maîtrise du médium de l’écriture musicale, une soif inextinguible de modernité, et le désir ardent d’entendre et faire entendre une musique jusqu’alors jamais entendue — atonalité, rythmes irrationnels, jeux sur les timbres et les contrastes. On peut même parfois déceler chez elles ce qui deviendra une signature de l’écriture boulézienne : alternance de plages de temps flottant, immobile, suspendu, durant lesquelles l’oreille contemple une résonance, et de moments de grande nervosité, heurtés de figures fugaces traversant à toute vitesse l’étendue entière du clavier.
1945 est l’année où Boulez entend pour la première fois la musique sérielle de Schönberg, son Quintette pour instruments à vent op. 26. C’est, confie-t-il à Antoine Goléa, « comme une illumination ». Et une émancipation, repérée par François Meïmoun : « La pensée sérielle vous libéra de ces gestes d’improvisateurs qui étaient une des marques du langage de Jolivet et de Messiaen », remarque-t-il dans son entretien avec le compositeur. On sait quelle méfiance Boulez entretiendra désormais à l’égard de l’improvisation, dans laquelle il voit l’action d’une mémoire instrumentale involontaire, manipulée, quand seule l’abstraction de l’écriture est à même d’engendrer des formes autonomes. Lui, dont l’oreille est absolue, ne compose plus au piano, mais « à la table », comme on dit. Malgré cela, la Première Sonate (1946) garde la trace du compositeur-pianiste, comme le montre un documentaire où on le voit dialoguer avec Pierre-Laurent Aimard : si ses mains parvenaient à sauter d’un bout à l’autre du clavier de manière infaillible, en revanche, dès qu’elles se croisaient, il était complètement perdu… ! Quoi qu’il en soit, le piano – tel qu’il est investi dans la Sonatine pour flûte et piano (1946) et les Première et Deuxième (1948) Sonates – permet à Boulez de démontrer la validité historique et formelle de l’atonalité et du sérialisme au regard de la tradition.
C’est précisément elle – la tradition – que le piano permet de questionner de manière radicale dans les années 1950. Le premier livre des Structures pour deux pianos fait du clavier un laboratoire d’expérimentation du « sérialisme intégral ». Il applique une table rase implacable, s’attaquant aussi bien à l’idée d’un langage musical hérité qu’à la notion même d’auteur, puisque l’expérience consiste en l’application mécanique, aux quatre paramètres du son (hauteurs, durées, dynamiques, timbres) d’un principe sériel issu de l’œuvre d’un autre (Mode de valeurs et d’intensités de Messiaen). S’il ne faut pas moins de deux pianos pour réaliser les combinaisons sonores complexes que les relations sérielles chiffrées ont générées, le clavier est conçu comme un espace neutre, homogène et isotrope, à l’image de l’espace abstrait dans lequel opère le scientifique. Avec la Troisième Sonate et le deuxième livre des Structures, c’est une interrogation tout aussi fondamentale sur la notion de forme que le piano permet de mettre en œuvre. Mobiles, proposant des parcours multiples laissés au libre choix du pianiste dans le vif de l’interprétation, ces œuvres sont de véritables « improvisations composées », comme les appelle Boulez, réintroduisant de l’indéterminé et de la subjectivité au sein du maillage extrêmement élaboré de l’écriture sérielle.
 — Dimitri Vassilakis
-
© F.Ferville
— Dimitri Vassilakis
-
© F.Ferville
Décentrement du piano
Les décennies suivantes, qui voient aussi décoller la carrière du compositeur chef d’orchestre, signent, sinon une éclipse, du moins un décentrement du piano – en tout cas comme instrument soliste, puisqu’il demeure présent à l’intérieur de l’orchestre boulézien, tout autant pour sa puissance polyphonique que pour son pouvoir de résonance, au sein d’alliages de timbres cristallins qu’il élabore avec un grand raffinement. Ainsi Éclat (1965), où le piano dialogue avec le vibraphone, le glockenspiel, les cloches tubes, la harpe, le célesta, le cymbalum, la mandoline et la guitare ; ainsi Répons (1981-1984), où l’électronique de l’Ircam déploie et augmente l’univers sonore de deux pianos, un vibraphone, un glockenspiel, une harpe et un cymbalum en conversation avec l’ensemble instrumental.
Dans cette trajectoire, les pièces pour piano seul composées dans les années 1980 à 2000 sont autant d’éclats de la créativité de Boulez. On sait ce que signifie le mot « éclat » dans le vocabulaire d’un compositeur chez qui un geste, une figure, un simple ornement peut proliférer et structurer une forme musicale se tenant par elle-même : « la brillance, les arêtes vives et tranchantes, le miroitement – mais aussi le fragment », comme l’écrivait Dominique Jameux à propos de l’œuvre éponyme. C’est ainsi qu’apparaît Fragment d’une ébauche (1987), dont les trente secondes fulgurantes ont été prélevées d’une œuvre pour piano et ensemble à l’état d’esquisse, qui n’a jamais vu le jour, et n’était sans doute même jamais destinée à exister. Cette réflexion sur la transfiguration formelle du geste instrumental par l’opération de l’écriture compositionnelle marque également la proximité et l’amitié de Boulez avec les grands interprètes du monde de la musique engagés dans la création. De même que Messagesquisse (1976-1977) pour violoncelle solo et six violoncelles est inséparable de l’énergie de Mstislav Rostropovitch et Anthèmes I (1991) pour violon de celle de Yehudi Menuhin, de même, Incises (1994-2001) pour piano est étroitement lié à Maurizio Pollini. Quant à sur Incises (1996-1998), qui projette dans la durée musicale et l’espace sonore de ses trois pianos, ses trois harpes et ses trois percussions-claviers le matériau d’Incises, comme si l’on ouvrait la grande boîte du piano pour déployer sur scène tout ce qui en jaillit (des sons, des histoires…), elle offre à l’instrument (et à nos oreilles) un des hommages les plus jubilatoires qui ait jamais été donné. De sur Incises, on sait aussi la fin saisissante lorsque, dans les toutes dernières mesures, le chef baisse les bras, cesse de diriger, et laisse les trois pianistes enchaîner librement les derniers accords, les dernières résonances. C’est aussi sur une résonance finale, frémissante, suspendue, que la dernière pièce pour piano que Boulez a composée, Une page d’éphéméride (2005), s’éteint, laissant mourir doucement le son vers un silence qui semble pourtant nous dire « à suivre… ».