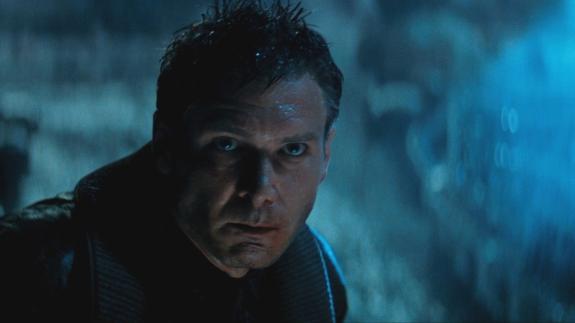Dans son livre Ni noires, ni blanches : histoire des musiques créoles, Bertrand Dicale décrit un aspect particulier des sociétés et cultures créoles : la fascination ambiguë. Une manière d’interroger le rapport entre musique et domination.
Que se passe-t-il lorsqu’un Blanc confie un violon à un de ses esclaves pour qu’il apprenne à en jouer ? En général, le maître sait que l’homme a une inclination, voire un talent pour la musique. Mais avec quel entrain l’esclave apprend-il le répertoire de quadrilles, de reels ou de valses qui sont nécessaires à une soirée dansante chez le maître ? Quel est le degré de contrainte dans le fait de jouer de la musique, de jouer ce répertoire-là et de le jouer avec l’intonation idéale dans l’interprétation ? La position de l’esclave au violon révèle toute l’ambiguïté de ces sociétés. Son intérêt est de jouer le mieux possible la musique voulue par le maître — indépendamment de tout ressentiment personnel —, même s’il reste au fond de sa mémoire des bribes d’une autre musique. Son intérêt concret et immédiat est de répondre le plus parfaitement possible à la demande du maître en termes esthétiques et de ne révéler aucune distance entre son jeu et celui d’un musicien qui ne partagerait pas sa situation — un musicien blanc, par exemple. Dans l’hypothèse d’un musicien bossale (hypothèse très peu vraisemblable, au demeurant), il ne peut incorporer dans son répertoire et dans son jeu d’éléments africains qu’avec l’assentiment de son maître, voire à sa seule demande expresse. Symétriquement, il est vraisemblable que l’esclave violoniste fasse montre, devant les autres esclaves, de ce savoir absolument « blanc ». Si l’on transpose en algèbre cette situation, on peut dire que le musicien esclave sera d’autant plus prospère (et donc proche de la liberté) s’il parvient à se confondre totalement avec la culture de ses oppresseurs, tandis que s’il s’en éloigne, il peut tout perdre — à commencer par le violon dont la pratique le protégerait d’un travail de force dangereux pour ses mains, par exemple.
Une des plus grandes douleurs qui traverse la psyché collective des descendants d’esclaves est la mémoire (affirmée, célébrée, héroïsée) des souffrances vécues, mais aussi la mémoire (niée, détournée, contournée) du consentement à cette position servile. Et l’aventure du violoniste esclave est évidemment dans cette ambiguïté qui lui fait quêter l’assentiment pour s’être vidé de sa propre identité — à moins que l’identité culturelle du maître et celle de l’esclave ne soient naturellement conduites à converger.
Ce que nous appelons fascination ambiguë est justement ce qui fait converger ces identités culturelles : le fait qu’une part de la population consente, contrainte et forcée, au modèle culturel dominant et que ce modèle culturel dominant soit intégré, approprié, pratiqué sans que l’on sache quelle est la part de la honte, c’est-à-dire du souvenir de la soumission à la contrainte. Cependant, la fascination ambiguë joue tout autant quand le dominant s’empare d’une part du bagage du dominé sans avoir le sentiment de céder quoi que ce soit de son statut prééminent. Ce phénomène explique les apparentes incohérences, contradictions ou trahisons que l’on allègue à l’écoute de la musique des uns ou des autres et surtout que le même univers culturel puisse être partagé par les uns et les autres dans des connivences parfois surprenantes.
Pour revenir à l’histoire de la langue créole francophone d’Amérique, un de ses secrets les mieux gardés est qu’elle a été longtemps la langue de connivence entre les anciens maîtres et les plus basses couches de la société, dans une sociabilité qui visait à exclure les fonctionnaires envoyés depuis Paris ou, en Louisiane, les affairistes arrivés en arrière-garde des armées yankees. Dans l’emploi de cette langue par des ruraux semblablement opposés aux incursions des citadins dans leur univers, on lisait évidemment des complicités liées au sol, mais aussi la trace d’une ancienne soumission. [...]
La fascination ambiguë ne vient pas amoindrir, apaiser ou consoler un conflit. Elle inclut une idée de rapt, de dérision, d’appropriation, en même temps qu’un réel respect — le respect dû au vainqueur, au notable, au chef d’entreprise ou au pater familias. Peut-être est-ce cette cinquième caractéristique des cultures créoles qui, paradoxalement, les cimente autant que la verticalité des cohérences du sol cimente les identités-racines. Peut-être cette expression tendue et parfois perverse des tensions internes à ces sociétés leur permet-elle d’atteindre une manière de solidarité culturelle, et donc existentielle.
Extrait de Bertand Dicale, Ni noires, ni blanches : histoire des musiques créoles, Éditions de la Cité de la musique - Philharmonie de Paris (La rue musicale), collection [anthropologie musicale], 2017, p. 78-81. Parution le 4 mai 2017.
Bertrand Dicale a présenté son ouvrage à la fin du colloque Coloniser / Décoloniser par la musique, le vendredi 21 avril à 18h30, en Salle de conférence de la Philharmonie. A réécouter sur Philharmonie à la demande.