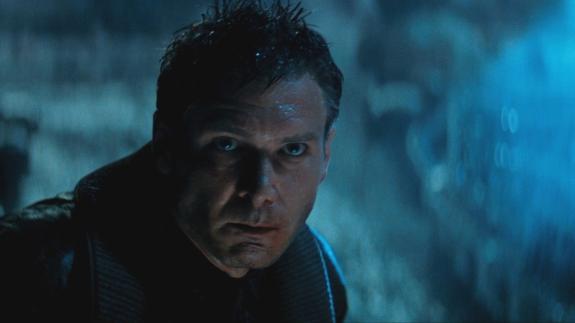Les “sound studies” s’introduisent dans le paysage francophone. Entretien avec Jonathan Sterne à l’occasion de la parution de son histoire de la modernité sonore.
Votre livre Une histoire de la modernité sonore propose une vaste historiographie des origines de la reproductibilité sonore au XIXe siècle
Une histoire de la modernité sonore trouve son point de départ dans une recherche bibliographique infructueuse menée en 1992. Je travaillais alors sur un mémoire de licence dans le cadre d’un cursus interdisciplinaire en sciences humaines. Certains de mes enseignants — Richard Leppert, John Mowitt, Gary Thomas — appartenaient à cette époque au champ de la « nouvelle musicologie » (New Musicology). Nous abordions quantité d’ouvrages et d’articles sur la modernité visuelle durant nos cours, mais son pendant sonore n’avait pas, ou peu, voix au chapitre. J’ai fait des recherches sans grand succès, même s’il existait sans doute davantage de sources que celles sur lesquelles un étudiant de licence pouvait tomber à ce moment-là — je pense notamment à Wireless Imagination de Douglas Kahn et Gregory Whitehead
Au début, j’ai pensé qu’écrire une histoire de la modernité sonore était une affaire théorique, mais à mesure que le projet avançait, deux choses se sont produites. Tout d’abord, j’ai compris à la lecture de certains de mes auteurs favoris — Michel Foucault, Pierre Bourdieu ou Lynn Spigel — que les avancées théoriques majeures ne vont jamais sans une nouvelle vision du monde. Cet aspect est également crucial pour les cultural studiestelles que me les a enseignées mon mentor Lawrence Grossberg. Parallèlement, j’en suis venu à la conclusion que les matériaux historiques sont plus étranges et plus intéressants que tout ce qu’il est possible d’imaginer : les récits qui concernent le phonautographe à oreille et certaines images reprises dans Une histoire de la modernité sonore sont tout bonnement fascinants. Le choix de me concentrer sur les technologies de reproduction sonore — la téléphonie, l’enregistrement sonore, la radio — est pragmatique. Outre le fait qu’il s’agit de pratiques acoustiques en tout point « modernes », elles ont deux avantages supplémentaires. D’importantes sources d’archives les documentent en raison du moment et des lieux où elles ont été conçues, et la recherche anglophone les a traditionnellement étudiées séparément. Je les ai bien sûr trouvées captivantes — et je suis toujours de cet avis. L’autre influence importante pour ce livre est mon oncle, Myron Weinstein, un philologue hébraïque qui a fait carrière à la Bibliothèque du Congrès. Il m’a enseigné les techniques de recherche en archives, et j’ai appris de lui que les matériaux ésotériques ou très pointus renferment des idées et des histoires d’une grande profondeur.
L’originalité de votre ouvrage tient en partie au fait d’étudier la reproductibilité sonore sans prêter attention ou presque au champ musical. Votre choix n’a rien d’un parti pris, puisque vous montrez de quelle façon l’audition s’émancipe du fait musical au XIXe siècle, dans le sillage d’importants bouleversements en médecine (notamment la pratique de l’auscultation médiate à l’aide du stéthoscope). Le champ de la musicologie anglo-américaine a toutefois pu avoir de sérieuses réticences vis-à-vis de votre ambition. Quelles ont été les réactions à la sortie du livre ?
De la part de la musicologie universitaire ? La première réaction a été le silence, pour l’essentiel. Évidemment, Une histoire de la modernité sonore n’est pas destiné avant tout aux musicologues : le livre est davantage tourné vers les débats qui agitent les cultural studies, les media studies, les science and technology studies, l’histoire, l’anthropologie, la sociologie et la littérature, parce que c’est de là que proviennent l’essentiel de mes lectures. J’ai aussi cherché une manière totalement différente de parler de la musique, qui m’a amené à mettre les exemples musicaux de côté. Le livre s’intéresse aussi bien aux concerts téléphoniques et aux anthropologues collectant des chants indigènes qu’aux interprètes nerveux à l’idée de chanter devant un micro, mais il ne propose pas d’analyse musicologique à proprement parler. Je désire appréhender la musique comme un élément d’un ensemble beaucoup plus vaste : la culture sonore.
Sur le plan musicologique, j’ai l’impression que mes premiers lecteurs sont venus de l’ethnomusicologie, champ dans lequel Steven Feld et d’autres ont beaucoup fait pour élargir les problématiques sonores. D’autres se sont consacrés à l’étude des musiques populaires, souvent hors des départements de musique, et des personnes comme Georgina Born ont fondé une tradition de réflexion sur la reproduction sonore. Hormis quelques figures — Tim Taylor, par exemple —, la musicologie universitaire ne m’a témoigné de l’intérêt que plus tardivement. Désormais, les croisements potentiels entre la musicologie et les sound studies suscitent beaucoup d’engouement. Je pense que cela tient au fait que bon nombre de musicologues (et de théoricien.ne.s de la musique) comprennent à présent que les sound studies leur offrent le moyen d’élargir leurs champs d’investigation, et leur permettent d’expliquer en quoi leurs travaux présentent un intérêt pour les sciences humaines au sens large. En ce qui me concerne, j’espère un jour écrire un livre entièrement consacré à la musique.
Vous avez fait auparavant référence à la « culture sonore », objet d’un champ de recherche méconnu en France, mais déjà bien établi dans le monde académique anglo-américain : les sound studies. Comment définiriez-vous les contours généraux de cette approche, à laquelle vous avez consacré un important reader
Si je devais définir les sound studies en une phrase, je dirais qu’elles appliquent à la question sonore les avancées intervenues dans les sciences humaines et sociales au cours du demi-siècle passé. Plutôt que de suivre les règles du jeu des disciplines instituées en privilégiant l’étude de la musique ou de la parole, elles considèrent le son et le monde acoustique comme des objets dignes d’intérêt intellectuel. À l’inverse, les sound studies suggèrent également que le son offre des voies d’accès alternatives à des problématiques centrales qui animent la réflexion en sciences humaines et sociales. C’est, à mon sens, la caractéristique la plus importante et la plus excitante de ce champ. C’est bien joli d’écrire sur le phonographe, mais l’essentiel de mon lectorat ne se passionne pas pour l’appareil. Il se compose de lecteurs attirés par des problématiques plus larges, touchant à la culture, au pouvoir, à la subjectivité. Tel est l’espoir que je place dans les sound studies : qu’elles traitent toujours de grandes questions historiques, philosophiques et politiques sous l’angle sonore. Des chercheurs dont le son n’est pas l’objet d’étude principal auraient ainsi l’opportunité de le croiser sur leur route, de la même manière qu’ils pourraient s’appuyer sur les Visual Culture Studies et sur leurs théories du regard afin de mener à bien un projet tourné vers quelque chose de totalement différent. Mes travaux favoris en sound studies ont tendance à suivre ce modèle. Voici quelques exemples parmi tant d’autres : The Soundscape of Modernity d’Emily Thompson, publié au même moment qu’Une histoire de la modernité sonore aux États-Unis, étudie comment le son est devenu une chose mesurable, gérable, mise en forme architecturalement
On peut aussi définir les sound studies par la combinaison d’un objet et d’une approche théorique: un travail sur le son ne relève pas automatiquement des sound studies, et un travail dans le champ des Sound Studies ne porte pas automatiquement sur le son. Tout dépend du réseau dans lequel s’inscrivent les chercheurs. Le son — et l’ensemble des objets qui lui sont liés — offre un accès alternatif aux problèmes majeurs qui accaparent la recherche contemporaine. Le parcours qui m’a mené à la rédaction de mon livre MP3 a complètement transformé ma manière de concevoir la numérisation, l’information et un certain nombre de processus historico-médiatiques au XXe siècle. Les historiographies visualistes ont tendance à associer la théorie cybernétique de l’information à la Seconde Guerre mondiale. Pourtant, une lecture appuyée de l’œuvre de Claude Shannon montre ce qu’elle doit à la parole et au téléphone. J’en ai tiré plusieurs conclusions. D’une part, la compression est une problématique centrale des médias au XXe siècle bien avant l’avènement du numérique. D’autre part, pour cette même raison, il se peut que les médias numériques ne marquent pas une rupture si radicale vis-à-vis de leurs prédécesseurs, du moins sur le plan sensoriel.
Pour en revenir aux relations qu’entretiennent les sound studies avec les cultural studies, tout dépend de ce que vous entendez par cultural studies ! De toute évidence, mon travail est fortement influencé par la tradition des cultural studiesbritanniques, mais de nombreux chercheurs en sound studies travaillent en-dehors de cette tradition. Prenons un exemple : je ne pense pas que Karin Bijsterveld ou Trevor Pinch, qui ont tous deux placé le son au centre des science and technology studies, associeraient leurs travaux aux cultural studies. D’un autre côté, je dirai qu’une recherche en Sound Studies, quelle qu’elle soit, requiert un concept de culture, faute de quoi elle risquerait d’aspirer à l’objectivité scientifique (ce qui constitue un concept problématique jusque dans les sciences dites « dures »). S’il ne fallait citer qu’une caractéristique essentielle des sound studies, ce serait la dimension critique.
L’une de vos thèses centrales est que la médiation original-copie ne constitue pas un appauvrissement de l’original, mais la construction réciproque de la copie et de l’original. Vous contrez ainsi un certain nombre de thèses « critiques » selon lesquelles « la copie est perçue comme un original appauvri, comme un événement acoustique ayant subi une perte d’être
Ce problème est au cœur de mes préoccupations sur le plan de la philosophie des médias, et dans une large mesure, il s’agit d’un projet théorique inachevé. L’une des choses positives issues des Lumières est l’idée que les circonstances de naissance d’une personne ne sauraient déterminer ses perspectives de vie. Des sociétés étendues, diversifiées et urbaines s’y prêtent mieux. Mon problème, c’est que la plupart des théoriciens des médias qui conçoivent une aliénation ou un appauvrissement sur le plan sensoriel le font par comparaison avec la communication en face-à-face, ou avec une expérience sensorielle primaire, soi-disant immédiate. Comme je l’explique dans l’introduction d’Une histoire de la modernité sonore, ce mode de pensée a fait l’objet de critiques venues de différentes traditions intellectuelles, allant du pragmatisme à la déconstruction.
Il se peut que de telles approches possèdent une théorie de la justice opératoire (ou implicite) pour une société de grande envergure, mais en mettant en avant un fantasme d’expérience immédiate comme point de comparaison, elles ne proposent aucune théorie de la communication adaptée à cette imagination sociale. Même si cette relation intersubjective pleine et entière que détourneraient les médias existe bel et bien, elle n’est pas toujours possible, ni même désirable dans une société élargie. Pensez au livre de Marc Augé Un ethnologue dans le métro
Mon but est de prolonger les analyses de la technologie et du pouvoir que proposent les cultural studies, le féminisme et les science and technology studies en les ouvrant à ce que les médias sont, à ce qu’ils font, et à quoi ils servent. L’idée selon laquelle une technologie médiatique n’est qu’un ersatz décevant de relation en face-à-face omet quantité de choses. Comment faire l’histoire du jazz sans enregistrements ? Celle des printemps arabes sans les médias sociaux ? Celle de cinq siècles de littérature et de poésie sans codex ? Dans chacun de ces exemples, les technologies de communication ne sont pas des agents de causalité unifiés, mais leurs caractéristiques matérielles sont profondément liées — articulées — à des aspects de ces histoires qui transcendent l’échelle individuelle. Des échelles d’expérience, d’action et d’organisation sociale différentes ne sont pas de simples homologies.
Je pense qu’il est possible d’écrire des histoires et des ethnographies de cette façon, mais qu’elles sont inachevées sur le plan philosophique et normatif. Quels sont les objectifs des technologies de communication dans une société juste ? Quels rôles jouent-elles lorsque nous défions l’ordre des choses existant et lorsque nous imaginons des alternatives pour lesquelles nous sommes prêts à nous battre ? Les réponses pragmatiques et circonstanciées sont plus faciles à formuler que les grandes thèses philosophiques, mais la philosophie n’en reste pas moins nécessaire.
Vous avez donc consacré en 2012 un ouvrage entier au format mp3, à paraître en français en 2016. Pouvez-vous revenir sur ce projet en guise de conclusion ?
En plus d’aborder l’élément de distraction dont j’ai parlé plus haut, MP3 propose un siècle d’histoire d’un format qui n’a que deux décennies d’existence. Le mp3 demeure le format audio le plus répandu dans le monde, car sa taille est réduite comparée à celle d’autres types de fichier audio ; il est par conséquent plus facile à conserver et à transmettre. Cette facilité résulte d’une modélisation mathématique des blancs et des lacunes de l’oreille humaine. Mon livre retrace l’émergence du sujet auditeur construit dans chaque fichier mp3. Il propose en outre une version alternative de l’histoire des médias au XXe siècle. Bien que nous soyons moins enclins à produire des téléologies sur l’histoire en général, il demeure relativement commun de trouver des récits téléologiques sur la façon dont les technologies médiatiques visent et parviennent à un réalisme toujours plus important grâce à une plus grande définition, même si, comme l’a écrit Michel Chion, la définition n’est pas synonyme de réalisme. Je qualifie cette tendance d’histoire générale de la vraisemblance, et je suggère qu’il existe d’autres cadrages historiques possibles pour définir le travail techno-esthétique des médias. Pour MP3, ce qui compte est l’histoire générale de la compression, dans laquelle l’efficacité est au moins aussi importante que le réalisme comme objectif d’ingénierie. Cette histoire remonte à la compagnie de téléphone AT&T, qui a associé l’amélioration de ses infrastructures à certaines recherches fondamentales sur l’oreille humaine. Depuis lors, les questions d’audition ont été inextricablement liées à l’émergence du concept d’information. Et depuis lors, toute nouvelle forme médiatique est autant régie par sa capacité à conserver et à transmettre en relation avec un ensemble de limites prédéfinies que par la représentation d’une réalité extérieure. MP3 retrace cette histoire, et le livre a également beaucoup de choses à dire sur l’échange de fichiers et l’objectité de la musique…
Extrait d’un entretien à paraître dans le numéro 11 de la revue POLI - politique de l’image (octobre 2015).