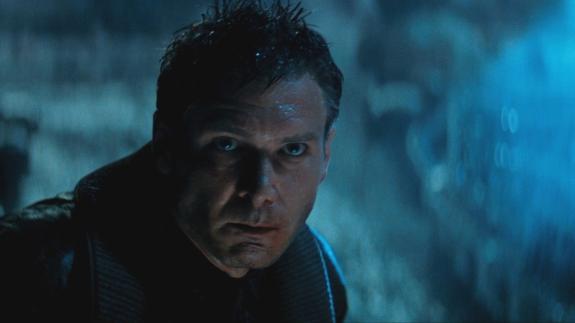Pionnier des musiques électroniques, explorateur insatiable de nouvelles sensations musicales, Pierre Henry retrace l'ensemble de son œuvre dans ces entretiens menés par Franck Mallet.
Extrait.
 — Pierre Henry en 2012
-
© BM Droits réservés
— Pierre Henry en 2012
-
© BM Droits réservés
J’étais jeune et ambitieux quand j’ai rejoint Pierre Schaeffer à la Radio, rue de l’Université. J’avais déjà réalisé chez moi, à la campagne, des objets sonores au sens propre, c’est-à-dire des bidules qui sonnaient, qui fonctionnaient. De faux pianos, de fausses timbales… J’écrivais déjà pour chant, pour piano, pour quatuor à cordes, ainsi que pour mes « objets sonores » depuis 1945. J’ai apporté tout ça au Studio d’essai — mes tiroirs. C’était peut-être modeste, mais ça existait : un fond musical de jeunesse. Il faut dire qu’à peine sorti du Conservatoire, tout en entamant une carrière de pianiste et de percussionniste au sein de plusieurs orchestres, je composais déjà. Je suis donc arrivé làbas, on m’a fait passer un examen d’improvisation au piano, avec des préparations assez percutantes et fracassantes, et l’on m’a dit : « Ça, c’est très bien, vous verrez avec nos différents moyens d’enregistrement, votre musique va être démultipliée, et bien plus originale. » J’avais donc passé brillamment mon « brevet » de musique concrète !
Schaeffer avait une idée précise du canevas de la Symphonie : il avait d’ailleurs réalisé un premier mouvement, Prosopopée, à partir de plusieurs disques de sillons fermés, dont le contenu était essentiellement des enregistrements de voix. Nous avons décidé de réaliser ensemble cette Symphonie pour un homme seul, mais avec les moyens d’enregistrement et de montage rudimentaires du support — le disque : un sillon, un sillon fermé, une plage, et ainsi de suite, un autre disque, passer de l’un à l’autre, les mélanger, réenregistrer les mélanges et trouver le moyen de les prolonger avec des effets. À l’époque, j’étais assez fier d’avoir découvert un effet de réverbération acoustique, que l’on a nommé « accrochage ». Pour cette Symphonie, j’avais apporté mes quatuors à cordes — des sons de cordes de violon — et d’autres éléments. Puis, entre fin 1949 et 1950, nous avons abouti à une oeuvre d’une heure vingt, créée à l’École normale de musique de Paris, le 18 mars 1950. Comme un disque souple ne contient en moyenne pas plus de huit minutes de musique — grosso modo la durée d’un 78 tours —, il a fallu transporter deux énormes tourne-disques (plus larges que ceux d’aujourd’hui) dans la salle de diffusion, où l’on posait alternativement les disques, que l’on prenait soin d’enchaîner pour éviter toute rupture dans la diffusion : il fallait être synchrone, comme pour les bobines dans une salle de projection.
Cette version complète en vingt-deux mouvements, personne ne la connaît pour la bonne et simple raison que je ne l’aime guère. Elle est maladroite et trop démonstratrice dans sa volonté d’épuiser tous les moyens et toutes les formules sonores du moment. En outre, elle manquait de maîtrise et de cohésion dans le montage. Aussi, dès que j’ai pu disposer d’un magnétophone, au cours de l’été 1951, je l’ai copiée sur bande pour réaliser un montage beaucoup plus resserré, qui est la version que l’on connaît, en concert, sur disque et pour les chorégraphies. Mais sa popularité et son succès viennent du choix de Maurice Béjart d’en faire une chorégraphie, quatre ans plus tard, au cours de l’été 1955, au théâtre de l’Étoile : la musique concrète lui en sera éternellement redevable.