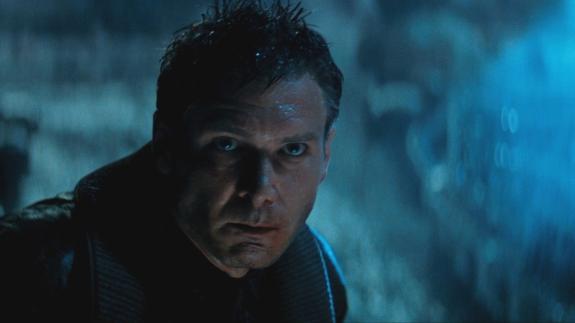Mariss Jansons fait admirer le grand son allemand, mêlant subtilement connaissance profonde de la tradition et inscription sensible dans notre temps.
Deux images nous viennent à l’esprit à l’évocation du chef d’orchestre letton Mariss Jansons, (Riga, 1943). La première est une photo prise lors de la deuxième édition du concours de direction d’orchestre Herbert von Karajan. Quatre impétrants sont alignés sur scène aux côtés du Maestro : Emil Tchakarov, Antoni Wit, Mariss Jansons et Gabriel Chmura. Si tous ont fait carrière, aucun n’a connu reconnaissance aussi universelle que celle dont jouit aujourd’hui Jansons. La seconde est une flamboyante Quatrième Symphonie de Tchaïkovski donnée en 1988 à la Salle Pleyel avec l’Orchestre philharmonique de Leningrad, sous le regard impassible de son aîné Kurt Sanderling. Depuis, Paris l’a beaucoup entendu, à la Salle Pleyel comme au Théâtre des Champs-Élysées, et désormais à la Philharmonie de Paris, au pupitre des Philharmoniques d’Oslo et de Vienne, du Concertgebouw d’Amsterdam ou de l’Orchestre symphonique de la Radio-Bavaroise. Cette dernière phalange, qu’il dirige le 31 octobre, est la seule dont il demeure en 2019 directeur musical, Chefdirigent.
Jansons a aujourd’hui atteint un classicisme supérieur, qui lui appartient. On peut trouver plusieurs raisons à cela: d’abord une présence physique, une autorité naturelle, une technique de direction claire et persuasive, épurée comme toujours par l’âge et l’expérience. Ce qui n’exclut ni le panache, ni l’inspiration du moment ; il faut également souligner son sens superlatif de la forme, éclairé par la justesse fascinante de ses transitions. En outre, l’instinct musical de cet artiste de grand savoir embrasse un répertoire d’un éventail stylistique considérable, au concert comme au disque. Le Concerto pour orgue de Poulenc, qu’il a joué en mars 2019 à la Philharmonie, effrontément couplé à Berlioz et au Sacre du printemps de Stravinski, a aussi fait l’objet d’une captation à Amsterdam. Passé par Vienne, où il fut comme tant d’autres élève du réputé Hans Swarowsky, remarqué par Karajan, Jansons a d’abord étudié à Leningrad (alors), où son père Arvid, lui-même grand directeur d’orchestre, secondait le légendaire Evgueni Mravinski. Cette double influence a fondé deux piliers de son répertoire : la musique austro-allemande, en particulier romantique et postromantique, et le monde russe, au sein duquel Chostakovitch ochiccupe une place centrale, ce qui est autant une question historique, générationnelle, que d’affinités électives.
La plénitude qui émane de longue date de son art explique qu’après Oslo et Pittsburgh, il ait été nommé en 2003 à la tête de l’Orchestre symphonique de la Radio Bavaroise (où, comme à Pittsburgh, il succédait à Lorin Maazel), puis, dès 2004, à l’Orchestre Royal du Concertgebouw d’Amsterdam (où il s’installait dans le fauteuil de Riccardo Chailly). Depuis Karajan, patron à Vienne et à Berlin au début des années soixante, l’Europe n’avait plus connu de chef ochiccupant simultanément deux fonctions aussi importantes, surtout s’agissant de formations au profil artistique somme toute assez similaire. On s’est amusé à noter au fil des ans avec quelle diplomatie Jansons veillait à éviter toute schizophrénie directoriale, alternant avec soin ses visites avec l’une puis l’autre, en un lieu ou un autre (le Théâtre des Champs-Élysées versus la Salle Pleyel, aujourd’hui la Philharmonie de Paris). Ce qui était tout bénéfice pour son public, et valait pour le répertoire enregistré en concert par les labels de chaque orchestre, BR Klassik et RCO Live : à l’un Mahler, à l’autre Bruckner, aux deux Strauss ou Stravinski. Et inversement après quelque temps…
Lui-même, en 2009, reconnaissait éprouver de la peine à les départager. Il nous avait dit alors voir en l’Orchestre de la Radio Bavaroise un ensemble virtuose et spontané, au riche tempérament, faisant la part belle à l’émotion, et possédant le vrai grand son allemand, dans la plus haute acception du terme. Le Concertgebouw lui apparaissait comme un orchestre raffiné, au son très personnel, car relevant d’une tradition spécifique, développée en relation étroite avec sa salle et ses directeurs musicaux successifs. Des soucis de santé, conjugués à l’énorme charge de travail induite par cette double casquette, l’ont conduit en 2015 à renoncer à l’ensemble amstellodamois – lequel l’a derechef nommé Conductor emeritus. C’est donc avec son orchestre bavarois qu’il nous revient ce 31 octobre, dans un programme illustrant ce que suggérions plus haut : il réunit en effet Beethoven (on attend avec impatience le Deuxième Concerto pour piano avec Rudolf Buchbinder en soliste) au Chostakovitch de la Dixième Symphonie. Deux compositeurs dont il a joué et gravé l’intégrale des symphonies, deux créateurs nourriciers de son imaginaire musical. Et qu’il a toujours su présenter au public en mêlant subtilement connaissance profonde de la tradition et inscription sensible dans notre temps.