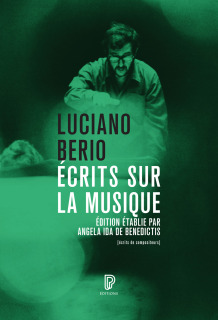Formation
Issu d’une lignée de musiciens et de compositeurs remontant à la seconde moitié du XVIIIe siècle, Luciano Berio naît le 24 octobre 1925 à Oneglia, un quartier de la commune d’Imperia, en Ligurie, sur les rives de la Méditerranée, peuplé de marchands d’huile et de pêcheurs. Jusqu’à ses 18 ans, la musique s’incarne pour lui dans les patriarches qui dominent la famille, avant d’intégrer le Conservatoire de Milan en 1945. Son grand-père Adolfo, qu’il admire, même s’il dit de lui qu’il est « un homme plutôt fermé et égoïste », est un « musicien pragmatique » et « authentique ». Organiste, il compose des polkas, des messes et des valses. À l’inverse, la musique de son père, « plus conventionnelle » et « bourgeoise », le laisse presque indifférent. C’est pourtant ce dernier qui forge sa première éducation musicale. Il l’oblige à apprendre à jouer « tous les instruments » (violon, piano, clarinette) et organise à la maison des concerts de musique de chambre, réunissant des « instrumentistes excellents, presque tous des petits commerçants d’huile ou de savon », pour interpréter Mozart, Beethoven, Schubert, Schumann ou Brahms. Berio se souvient de ces concerts comme d’une « oasis d’une félicitée absolue », au milieu du désert musical qu’est devenue l’Italie de Mussolini. Il devra attendre 1945 pour entendre les œuvres de Schönberg, Stravinski, Webern et Bartók. Enfin, la troisième figure importante pour Luciano Berio est son oncle. Il dit de lui qu’il « était un peu comme le pain fait à la maison, rude, simple ». Puis précise, en comparaison : « Mon père [était] comme le pain du boulanger, plus raffiné mais avec moins de goût. Mais du pain quand même. » Dans ce creuset familial baigné de lumière, se dessinent déjà les premiers motifs d’une personnalité musicale.
Artisanat musical
D’abord, un « grand amour pour le travail concret ». L’artisanat musical demande que l’on plonge les mains dans la matière sonore, comme une pâte que l’on pétrit. C’est cet amour qui le pousse, en 1955, à fonder le Studio di Fonologia de la RAI de Milan, premier studio italien de musique électronique, avec son grand « maître et ami », le compositeur et chef d’orchestre Bruno Maderna (1920-1973), rencontré peu de temps auparavant. Cette expérience lui permettra, à la demande de Pierre Boulez dont il a fait la connaissance à Darmstadt en 1951, de diriger le département d’électroacoustique de l’Ircam, de sa fondation en 1974 jusqu’en 1980. Avant cela naissent Thema (Omaggio a Joyce) en 1958, puis Visage en 1960, œuvres saisissantes où l’électronique donne à entendre la frontière poreuse qui à la fois relie et sépare le son et le sens des mots. Elles explorent le grain de la voix de Cathy Berberian (1925-1983), épouse de Berio depuis 1950. Leur complicité musicale subsistera après leur séparation en 1964.
Gestes vocaux du quotidien
La chair des mots, la pulpe sonore du langage, l’avènement du sens, la musique de Luciano Berio ne cesse de les explorer. Dans O King (1967), la voix entonne d’abord les voyelles, puis les consonnes qui forment le nom de Martin Luther King. Les instruments accompagnent en imitant les sonorités et c’est seulement à la toute fin que son nom est prononcé en entier. La Sequenza III (1965) pour voix, composée avec et pour Cathy Berberian, donne à entendre le passage progressif du bruit au chant et retour. Elle intègre les gestes vocaux du quotidien (cris et chuchotements, rires et bruits de bouches…) dans un langage sonore et musical, comme lorsque le rire se métamorphose en vocalise. Cette œuvre est issue d’un cycle de quatorze œuvres solo, intitulées chacune Sequenza, qui explorent l’histoire de la virtuosité instrumentale – de la flûte à la harpe, du trombone au piano, de la guitare au basson, de la trompette à l’accordéon.
Le théâtre du langage
Ce petit théâtre de la voix conduit tout naturellement Berio à collaborer avec ses amis écrivains Umberto Eco, Eduardo Sanguinetti et Italo Calvino, pour s’aventurer vers le grand théâtre du langage et des gestes : l’opéra. C’est à chaque fois l’occasion de jouer avec les formes et les conventions, de superposer les histoires fragmentaires et de multiplier les niveaux de lecture. Opera (1969-1970), composé avec Umberto Eco, mêle le mythe d’Orphée, le naufrage du Titanic et Terminal, une pièce de théâtre qui prend place dans le service des soins palliatifs d’un hôpital. Un re in ascolto (1979-1984), « action musicale » imaginée avec Italo Calvino, n’a ni intrigue ni événement ni émotions exprimées par des personnages. On y suit l’histoire d’un directeur de théâtre, nommé Prospero, seul dans son bureau pendant qu’un nouveau spectacle musical est en répétition. Il rêve d’un autre théâtre, puis meurt seul, sur une scène vide.
Folklore et musiques populaires
L’autre grand amour d’enfance qui irrigue toute l’œuvre de Berio est celui du folklore et des musiques populaires. La Sequenza III cherche ainsi à « laisser sortir la voix comme elle est dans la vie, pas cultivée. Et ce qu’il se passe souvent quand on procède de cette façon-là, c’est une sorte d’explosion des racines cachées dans les pratiques populaires ». Les musiques populaires du monde entier sont au cœur des Folk Songs (1964), arrangements pour voix et six musiciens de chansons américaines, siciliennes, arméniennes, auvergnates, azéries… Ce projet est suivi de Voci (Folk Songs II) (1984), pour alto et deux groupes d’instruments, où chants siciliens de travail et d’amour, berceuses et chansons de rue sont retranscrits, analysés, déconstruits, métamorphosés… Et enfin Coro (1974-1976) que Berio qualifie d’« œuvre sans ombre », « en plein soleil ». Dans cette pièce extraordinaire, quarante voix, chacune associée à un instrument, exaltent les chants traditionnels perses, indiens, croates, hébreux, péruviens… Elles revisitent les techniques vocales traditionnelles, du lied à la chanson, des hétérophonies africaines à la polyphonie, pour les appliquer à une nouvelle musique.
Reconfiguration et métamorphose
La transcription – pensée comme réflexion, reconfiguration et métamorphose d’une musique existante lorsqu’on la baigne dans un paysage musical nouveau – constitue une opération artistique centrale de l’esthétique de Berio. C’est le principe des Chemins qui offrent un commentaire orchestral aux Sequenze. « Le problème qui est peut-être le plus profondément enraciné en moi, c’est de mettre ensemble, de donner un ordre à des choses apparemment hétérogènes (…), de trouver des liaisons “internes” entre des éléments différents. » Si ce procédé irrigue nombre des œuvres de Berio – jusqu’à ses arrangements de chansons des Beatles –, l’exemple le plus électrisant en est sans doute le troisième mouvement de la merveilleuse Sinfonia pour huit voix et orchestre (1968). On y entend le Scherzo de la Deuxième Symphonie de Mahler faire proliférer un carnaval de citations « de Bach à Schönberg, de Beethoven à Strauss, de Brahms à Stravinski, de Berg à Boulez, etc. » agissant les unes sur les autres, se transformant mutuellement, s’engendrant réciproquement.
Berio le joueur
Bien qu’extrêmement élaborées, les techniques et procédures de composition ne sont ainsi jamais fétichisées, mais toujours mises au service d’un projet expressif. Sa musique est généreuse et chatoyante, espiègle et jubilatoire, ses œuvres sont comme une fête. Compositeur très joueur, Berio faisait du rire une méthode pour continuer l’exploration de cet océan de sons dans la musique. « Rien n’est jamais fini, dit-il un jour. Même l’œuvre achevée est rituel et commentaire de quelque chose qui viendra après… comme une question qui ne provoque pas seulement une réponse, mais encore un commentaire, d’autres questions et d’autres réponses… »
À l’occasion du centenaire de la naissance de Luciano Berio, les Éditions de la Philharmonie publient pour la première fois en français l’ensemble de ses Écrits sur la musique. Figure majeure de l’avant-garde du XXe siècle, pionnier de la musique électronique et attentif aux musiques populaires, il déploie une pensée vaste et profonde qui se reflète dans ces textes rédigés tout au long de sa vie.